La vie politique suit son cours, avec ses partis plutôt constitués autour d’une personnalité que d’une idéologie et de ce fait relativement fluides. Le développement économique du pays est embryonnaire et l’État reste le premier employeur avec pléthore de fonctionnaires (à commencer par les députés au Parlement), bien plus nombreux en proportion que dans les autres pays d’Europe occidentale.
La vie grecque est extrêmement politisée (dans les années 1980, lorsque j’habitais en Grèce, la politique était au centre de presque toutes les conversations), chaque politicien tendant à vouloir constituer des coalitions sans cesse mouvantes. Les élections sont enfiévrées, chaque changement de gouvernement entraînant un chambardement chez les employés de l’État. L’instabilité gouvernementale reste une constante de la vie politique et sociale grecque dont le lubrifiant est le patronage, un héritage venu de la longue occupation ottomane (du XIVe siècle au XIXe siècle). Ce qui compte avant tout, c’est d’avoir la bonne relation face à cette bureaucratie pléthorique et inerte. Le rousphetti (soit l’échange de faveurs) permet aux uns et aux autres de se mouvoir dans cette machine étatique qui somnole tout en prospérant aux frais du contribuable. Les lois que le Parlement élabore en grande quantité représentent pour les Grecs ce qui doit être contourné, et ils s’y entendent. Le système du patronage est une réponse à la dureté et à l’arbitraire du système de gouvernement ottoman. Il faut des protecteurs et des médiateurs pour affronter les autorités ottomanes et se prémunir des caprices du système juridique. Les Grecs jugent que les impôts levés par le jeune État sont à peine moins pesants que ceux levés par l’Ottoman. Les comportements élaborés par les Grecs soumis à l’Ottoman perdureront bien après son départ.
 Georges Ier de Grèce
Georges Ier de Grèce
(Je me permets à ce propos d’ouvrir une parenthèse. Les problèmes que l’Europe a eu récemment avec la Grèce doivent être compris non pas à partir d’une lecture idéologique dans le genre : les pauvres Grecs sont victimes du capitalisme international et des banques, etc. La question doit être envisagée plus finement et elle nécessite à cet effet de considérer les Grecs de leur propre point de vue, ce qui n’est possible qu’à partir d’une certaine expérience de la vie grecque. Ainsi ai-je pu en Grèce prendre la mesure de la défiance grecque envers son propre État et au-delà des gouvernements, avec refus de l’impôt, etc. Une telle attitude n’était pas pour me déplaire (euphémisme) mais le problème était que tout en voulant échapper à l’État, les Grecs voulaient en profiter, en vivre et en faire vivre leurs familles et relations, soit la parea (παρέα), le plus grec des mots qui inclut l’ensemble des relations, proches et lointaines, y compris celui que l’on vient de rencontrer dans une taverne autour d’un verre d’ouzo. C’est extrêmement sympathique, mais lorsque tout ce paquet s’accroche à l’État via une relation, ça pèse sur les finances publiques. La parea avait et a probablement encore une fonction essentielle dans la vie sociale du pays mais il faut savoir qu’elle explique au moins en partie l’état des finances grecques et les problèmes que l’Europe a eu à affronter avec la Grèce, l’Europe qui ne connaît la Grèce que par son soleil et ses ruines. Lorsque la Grèce est entrée dans l’Union européenne (alors Communauté économique européenne) en 1981, j’ai souri, sachant par ailleurs que les Grecs sont les champions du trafic comptable. J’en ai fait part à des amis en leur rappelant les paroles d’une chanson de la grande Mélina : « Si tu aimes les aubaines, les problèmes, les échecs / Prends le risque et viens vite, je t’invite, je suis grecque / Je vais te tirer les cartes, et dans ta vie je vois / Des voyages, des nuages, des orages avec moi / Des voyages, des nuages, des orages avec moi ». Je ferme la parenthèse).
Donc, dans ce jeune État grec, soit une démocratie parlementaire, les Grecs transposent les comportements élaborés face aux autorités ottomanes. Et la chose fonctionne plutôt bien, avec les kommatarkhis (plus ou moins l’équivalent du cacique espagnol) qui remplacent leur équivalent ottoman, le ağa.
Le monde grec est alors ouvert, fluide. Certes, l’oligarchie politique se perpétue mais les chemins qui y conduisent sont divers et d’un accès relativement aisé, sans considération pour les origines sociales. Il suffit de savoir manœuvrer plus habilement que ses concurrents. Les hommes politiques sont donc particulièrement sollicités et ils s’efforcent de répondre aux sollicitations y compris des plus modestes – on ne sait jamais… –, loin du débat public.
Vers la fin du XIXe siècle, le système politique se modernise, avec des hésitations certes. En 1875, le roi Georges Ier accepte le principe selon lequel il ferait systématiquement appel au responsable du parti jouissant de l’appui de la majorité des députés au Parlement pour former un gouvernement. Ce n’est toutefois qu’en 1881 que Kharilaos Trikoupis (Χαρίλαος Τρικούπης) parvient à assurer une majorité parlementaire. Au cours des décades 1880-1890, son parti et celui de son rival Theodoros Deliyannis (Θεόδωρος Δηλιγιάννης) alternent au pouvoir.
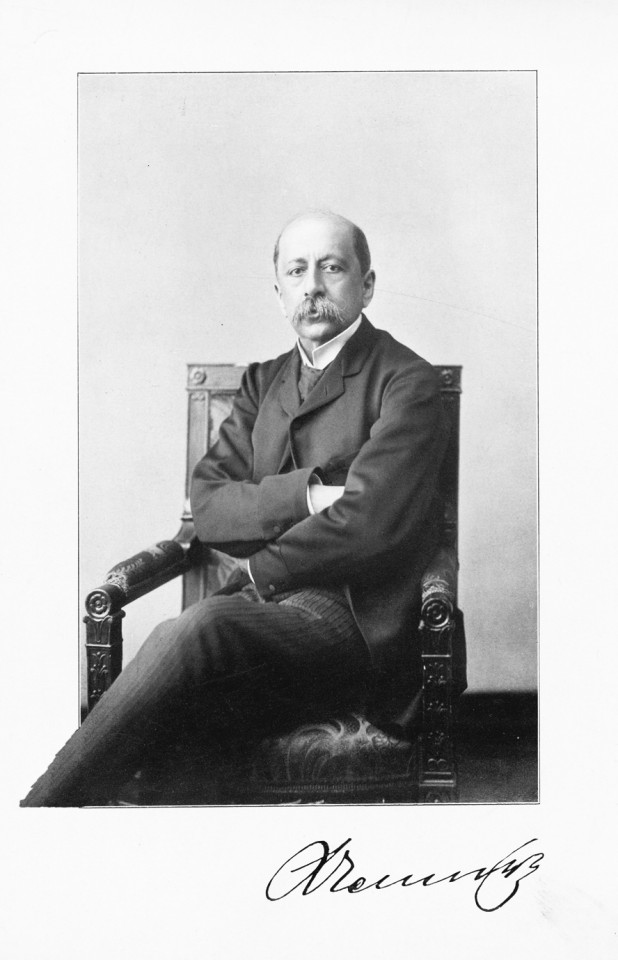 Kharilaos Trikoupis (1832-1896)
Kharilaos Trikoupis (1832-1896)
Trikoupis est une figure centrale de l’histoire de la Grèce moderne. Il représente en politique la tradition occidentale. Il est partisan du renforcement de l’État tant au niveau politique qu’économique. A cet effet, il commence par vouloir donner une crédibilité internationale à son pays, à y stimuler un début d’industrialisation, à y améliorer les communications, notamment par le chemin de fer et le percement du canal de Corinthe. Par ailleurs, il modernise l’armée et la marine. Tout ce programme est fort coûteux et augmente la pression fiscale, ce qui suscite un mécontentement général que sait exploiter son adversaire, Deliyannis, un démagogue à la rhétorique flamboyante, un partisan de la « Grande Idée » (Μεγάλη Ιδέα), qui pourrait également se traduire par « Greater Greece », un homme plus à même que l’austère Trikoupis de séduire l’homme de la rue. Mais l’aventurisme de Deliyannis va trouver ses limites et frapper durement l’économie de son pays suite à la mobilisation qu’il impose au cours de la crise bulgare 1885-1888 qui contraint les Puissances protectrices à imposer un blocus. La crise bulgare est l’un des nombreux épisodes de la crise balkanique suscitée par la lutte des États vassaux contre l’Empire ottoman, lutte qui conduit à une balkanisation (expression entrée dans le langage courant et toujours très active), avec alliances particulièrement instables qui provoqueront bien des guerres.
L’aventurisme de Deliyannis est également responsable de la défaite grecque au cours de la « guerre de Trente jours » qui oppose la Grèce à l’Empire ottoman en 1897, en Thessalie et en Épire. A la fin du XIXe siècle, en Grèce, la politique étrangère tend à dominer les affaires domestiques. L’Énosis (ἔνωσις) est également à l’origine des nombreux soulèvements en Crète (1844, 1858, 1866-69, 1877-78, 1888-89, 1896-97), ce qui perturbe les relations avec l’Empire ottoman et oblige les Puissances protectrices à intervenir. Mais c’est surtout au nord que la tension gagne, avec les provinces frontalières entre la Grèce et l’Empire ottoman et la grande crise qui agite les Balkans entre 1875 et 1878. Les Grecs mais aussi les Britanniques, les Austro-Hongrois et les Serbes s’inquiètent des prétentions russes à la suite de leur écrasante victoire sur les forces ottomanes, en 1877-78, d’une « Grande Bulgarie » autonome qui engloberait les territoires convoités par les nationalistes grecs. Au congrès de Berlin, été 1878, le projet d’une « Grande Bulgarie » est fortement revu à la baisse. L’Empire ottoman doit céder à la Grèce la plaine fertile de Thessalie et une partie de l’Épire. Autre conséquence de ces tensions dans les Balkans, l’administration par les Britanniques de Chypre, en 1878 (voir la Cyprus convention), une île à la population très majoritairement grecque. L’île restera sous souveraineté ottomane jusqu’en 1914, année où elle sera annexée par les Britanniques. L’annexion de la Thessalie et d’une partie de l’Épire constitue la deuxième phase d’extension du petit royaume de Grèce, la première phase étant celle de la cession des îles Ioniennes par les Britanniques en 1864, ainsi que nous l’avons précisé. Cette extension correspond à une médiation des Puissances protectrices, ce qui porte les frontières du pays à la limite de la Macédoine. Au cours des deux dernières décades du XIXe siècle et de la première décade du XXe siècle, la Macédoine abrite un inextricable mélange de populations : Grecs, Serbes, Bulgares, Albanais, Turcs et Valaques. Avec l’émiettement de l’Empire ottoman, les nationalismes s’exacerbent dans les Balkans, chaque pays cherchant à se tailler une part aussi importante que possible dans cet énorme morceau. Les confrontations entre Bulgares et Grecs sont volontiers plus nombreuses et violentes qu’entre Grecs et Ottomans, ces derniers mettant en œuvre le divide and rule. La création d’une Église bulgare indépendante en 1870 constitue une étape majeure vers la création d’une Bulgarie indépendante, ce qui affaiblit l’emprise grecque sur l’Église dans la région et place ces deux Églises en compétition. La tension entre Grecs et Bulgares s’en tient aux mots via divers canaux avant de déboucher vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sur la violence armée, chaque pays soutenant des bandes de guérilleros à leur solde. Les tensions en Macédoine réactivent les tensions en Crète qui débouchent sur les révoltes du milieu des années 1890, appuyées par l’Ethniki Etairia (Εθνική Εταιρία ou National Society).

La Grèce se montre donc très agressive ; elle est sermonnée par les Puissances protectrices qui la remettent à sa place. La défaite qui fait suite à la guerre des « Trente jours » souligne avec netteté l’écart considérable entre l’agressivité grecque et ses faibles capacités militaires. Les conditions qui font suite à cette rapide défaite ne sont pas franchement défavorables à la Grèce.
Une International Financial Commission est mise sur pied afin de superviser le remboursement de la lourde dette extérieure de la Grèce. En 1893, Trikoupis alors Premier ministre avait officiellement dû déclarer la banqueroute du pays. Les médiocres perspectives économiques du pays favorisent une importante émigration, notamment vers les États-Unis à partir des années 1890. On estime qu’entre 1890 et 1914, quelque 350 000 Grecs (et très peu de Grecques) ont émigré, soit près de 1/7ème de la population du pays. Beaucoup partent avec l’idée de revenir en Grèce après avoir amassé un pécule mais bien peu reviendront. L’argent envoyé au pays par ces émigrés est essentiel pour l’équilibre de la balance des paiements.
L’écrasante défaite de 1897 conduit la Grèce à s’interroger, notamment sur l’écart entre ses ambitions et les moyens de ses ambitions. On se met à douter de la « Grande Idée ». L’Empire ottoman est certes en déconfiture mais l’affrontement armé ne risque pas de tourner à l’avantage des Grecs. Des intellectuels grecs en viennent même à se dire que l’avenir de leur pays réside dans une association avec les Ottomans, à partir du constat suivant : les Grecs qui résident encore dans l’Empire ottoman, soit plus de la moitié des Grecs du Proche-Orient, ont réussi à remettre sur pied l’essentiel de l’économie et à regagner une partie du pouvoir politique dont ils bénéficiaient avant 1821. Cette vision reste toutefois (très) minoritaire et l’idée d’une guerre de libération conduite au niveau national reste prépondérante ; mais elle a mûri suite à certaines déconvenues : il faut fortifier l’économie du pays avant de se lancer dans une guerre contre l’Empire ottoman.
La Grèce va réussir à sortir progressivement de son malaise pour se présenter comme une puissance émergente de la Méditerranée orientale. Sa volonté de réaliser la « Grande Idée » s’affirme ainsi qu’une confiance renouvelée dans sa mission civilisatrice au Proche-Orient. Le maître d’œuvre de cette confiance retrouvée est Elelthérios Venizélos (Ελευθέριος Βενιζέλος), le plus charismatique des hommes politiques grecs de la première moitié du XXe siècle. Il a commencé sa carrière politique dans la Crète devenue autonome (1897-1913). Suite au coup d’État de Goudi (κίνημα στο Γουδί), il est projeté sur le devant de la scène politique nationale.
 Le colonel Nikólaos Zorbás (1844-1920)
Le colonel Nikólaos Zorbás (1844-1920)
Le coup d’État de Goudi, conduit par le colonel Nikólaos Zorbás (Νικόλαος Ζορμπάς), un vétéran de la guerre gréco-turque de 1897, a lieu dans la nuit du 28 août 1909, à partir des casernes de Goudi situées dans la banlieue d’Athènes. Il a été pensé par une société secrète à l’intérieur même de l’armée, la « Ligue militaire » (Στρατιωτικός Σύνδεσμος). La Grèce veut sortir de l’état d’humiliation dans lequel l’a plongée la défaite de 1897 et effacer l’échec de l’Énosis de la Crète. La « Ligue militaire » envoie aussitôt un mémorandum au gouvernement exigeant le redressement du pays et de son armée. Georges 1er cède et nomme comme chef du gouvernement Kyraikoúlis Mavromichális (Κυριακούλης Μαυρομιχάλης), un tour de passe-passe qui ne satisfait pas les insurgés qui organisent une vaste manifestation populaire en septembre 1909. Considérant le risque d’enlisement, les insurgés font appel à Venizélos qui, respectueux des règles démocratiques, convoque des élections. Venizélos est aussi l’homme de la situation parce qu’il n’entretient aucun lien avec le vieux monde politique de la Grèce continentale et ses arrangements. Suite à la victoire de ses partisans au Parlement, en août et décembre 1910, il est nommé Premier ministre et met sans tarder en œuvre les réformes exigées. Son parti, le Parti des libéraux (Κόμμα Φιλελευθέρων), détient presque 300 sièges sur 362. Ce coup d’État est envisagé en résonance à la révolution des Jeunes-Turcs de 1908, une promesse de modernisation du pays qui a soulevé un grand enthousiasme en Grèce même, mais aussi une inquiétude car un Empire ottoman régénéré laisse supposer qu’il deviendra plus difficile de le déloger de Macédoine dont la ville principale, Thessalonique, avait été le centre de la conspiration Jeunes-Turcs. Alors que la Bulgarie profite de cette conspiration pour se déclarer pleinement indépendante et que l’Empire austro-hongrois annexe la Bosnie et l’Herzégovine, la Crète déclare l’Énosis avec la Grèce.
Venizélos a donc les coudées franches pour gouverner. Il veut moderniser l’économie et la vie politique tout en reprenant à son compte et agressivement la « Grande Idée ». Afin de montrer qu’il n’est pas une marionnette des militaires, il commence par réintégrer à son poste dans l’armée le prince royal Constantin dont le mémorandum (suite au coup d’État de Goudi) exige la démission et il libère les officiers emprisonnés pour s’être opposés à ce coup d’État.
(à suivre)
Olivier Ypsilantis