Tout d’abord une petite leçon d’économie sur le libéralisme avec Milton Friedman et son crayon jaune, captivant :
https://www.youtube.com/watch?v=SDUB4Pw39sg
Lorsque j’ai découvert Nouriel Roubini, je me suis dit que nous partagions certaines analyses ou, tout au moins, certaines impressions – il n’est pas si facile de démêler l’analyse de l’impression, l’analyse n’étant souvent qu’un effort pour expliquer une impression, une impression pouvant être le produit d’une analyse qui ne se perçoit pas comme telle mais qui en est bien une.
Quoi qu’il en soit, je rejoins pleinement Nouriel Roubini sur une possible reprise en U – et pourquoi pas en V ? – sur le court terme ; mais pour la suite… L’économie est sous perfusion/transfusion. Les banques centrales perfusent/transfusent, perfusent/transfusent, tout va très bien, tout va très bien… Mais si le liquide – les liquidités – ne manque pas, quelque chose ne va pas très bien dans les profondeurs de l’organisme du perfusé/transfusé, quelque chose qui a été profondément altéré, notamment par la crise financière de 2008.
Nouriel Roubini évoque une Great Depression. L’un de ses articles a un titre qui se passe de tout commentaire : « My prediction for a Great Depression is not about 2020 but the decade of the 2020s’ ». Il m’aide à préciser ce que je pressens, soit un avenir économique (et donc social) en L. C’est ce qui est connu dans ce lexique économique (décidément fort expressif et qui ne cesse de s’enrichir de néologismes et d’expressions) comme un « white swan ». Nouriel Roubini ouvre son article intitulé « The white swan harbingers of global economic crisis are already here » sur ces mots : « In my 2010 book, “Crisis Economics”, I defined financial crises not as the “black swan” events that Nassim Nicholas Taleb described in his eponymous bestseller but as “white swans”. According to Nassim Nicholas Taleb, black swans are events that emerge unpredictably, like a tornado, from a fat-tailed statistical distribution. But I argued that financial crises, at least, are more like hurricanes: they are the predictable result of built-up economic and financial vulnerabilities and policy mistakes. »
 Nouriel Roubini (né en 1958)
Nouriel Roubini (né en 1958)
(Une parenthèse à propos de ces trois expressions récemment intégrées par un lexique spécialisé : « black swan », « grey swan » et « white swan ». Nassim Nicholas Taleb propose les trois définitions suivantes pour chacun de ces « swans », toutes très précises :
« A black swan is a highly improbable event with three principal characteristics: it is unpredictable; it carries a massive impact; and, after the fact, we concoct an explanation that makes it appear less random, and more predictable, than it was. »
« A grey swan is a highly probable event with three principal characteristics: it is predictable; it carries an impact that can easily cascade; and, after the fact, we concoct an explanation that recognizes the probability of occurrence, but shifts the focus to errors in judgment or some other human form of causation. »
« A white swan is a highly certain event with three principal characteristics: it is certain; it carries an impact that can easily be estimated; and, after the fact, we concoct an explanation that recognizes the certainty of occurrence, but again, shifts the focus to errors in judgment or some other human form of causation. »)
Dans tous les cas, il m’arrive d’avoir peur. Et, curieusement, ces peurs trouvent des images dans le monde marin. Je ne sais pourquoi car la mer ne m’a jamais effrayé contrairement à la montagne. Ces images, et je reprends ce que j’ai évoqué dans de précédents articles : des hauts-fonds entre lesquels glisse la coque d’un paquebot (ce peuvent être des icebergs, et j’en reviens au « Titanic »), le Kraken (voir l’attaque du Kraken dans « Pirates of the Caribbean »), le Maëlstrom (voir la nouvelle Edgar Allan Poe, « A Descent into the Maelström ») et, plus modestement, cette voilure non réduite alors que le vent ne cesse de forcir.
Avec Nouriel Roubini je constate que la crise provoquée par cette pandémie en traîne une autre derrière elle, celle de 2008 dont les effets sont toujours sensibles. Certains se sont atténués mais d’autres se sont accentués. Le système n’a guère été assaini ; il est donc particulièrement vulnérable. Voir les dix risque majeurs qu’identifie ce professeur d’économie.
Ce qui est inquiétant, c’est que cette pandémie touche des économies qui ne se sont pas remises de la crise financière de 2008. Voir notamment les niveaux de la dette publique, des niveaux qui montent d’un coup et dans des proportions inquiétantes. La France par exemple est passée brusquement d’environ 100 % à 120 % d’endettement par rapport à son P.I.B. Quant au privé, il subira un endettement non moins inquiétant pour cause de perte de revenus tant pour les entreprises que les ménages. Alors, croissance en U ou bien en L ?
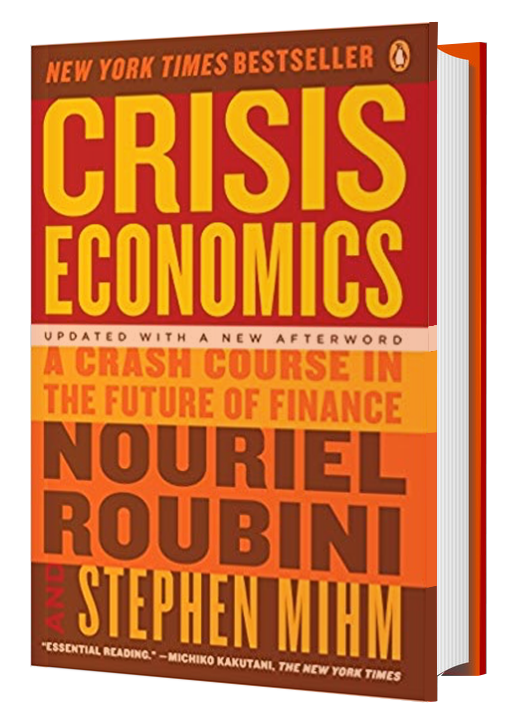
Nouriel Roubini décrit le scénario suivant, une hypothèse nullement fantaisiste même si personne ne sait vraiment que quoi demain sera fait. Il juge que la récession liée à la pandémie va provoquer un surplus conséquent des capacités de production et de main-d’œuvre, un déséquilibre donc entre une offre (forte) et une demande (faible), déséquilibre auquel s’ajoute une baisse conséquente du prix des matières premières essentielles (en partie pour cause de baisse de la demande), des mécanismes connus qui pourraient entraîner de la déflation. On espérait un peu d’inflation pour soulager (au moins temporairement) la dette publique, mais nous pourrions aller vers la déflation. A partir de là, un autre mécanisme s’enclenche : pour financer leurs déficits, les gouvernements font appel à leur banque centrale, avec planche à billets tournant à plein régime, d’où la stagflation (mot-valise formé de stagnation et inflation), stagnation de l’économie et inflation des prix, un mal auquel bien peu résistent et qui plonge les sociétés dans un état de crise économique, et donc sociale, dont il ne sort rien de bon, et je fais usage de la litote.
Nouriel Roubini poursuit dans sa lancée. La crise économique brièvement présentée ci-dessus et activée par la pandémie du Covid-19 pourrait être accentuée par la démondialisation et le protectionnisme. Démondialisation pour cause de disruption dans la fourniture de produits technologiques et crainte du retour de la pandémie – la deuxième vague si redoutée, autre image inspirée du monde marin et qui me revient, un tsunami. La démondialisation entraîne des pertes d’emplois et de salaires, avec creusement (abyssal ?) des inégalités sociales. La crainte d’un retour en force de la pandémie incite à la relocalisation, ce qui en soit peut paraître bénéfique mais, considérant la fiscalité et le coût de la main-d’œuvre dans le pays qui relocalise, l’automatisation y sera accélérée et les salaires auront tendance à partir à la baisse pour maintenir la compétitivité. Par ailleurs, considérant la gravité de la situation sociale (les Gilets Jaunes sembleront bien gentils en comparaison de ce qui pourrait advenir), les États et leurs gouvernements seront tentés par le protectionnisme afin d’éviter l’explosion ; ils restreindront la libre circulation des biens et des capitaux, ce qui aura les effets que je vous laisse imaginer…
Ce n’est bien sûr qu’un cas de figure parmi d’autres. Nouriel Roubini n’est pas un illuminé qui demande à ceux qui le lisent ou l’écoutent de le suivre les yeux fermés. Il avertit et désigne un possible sans écarter d’autres possibles. Et je pourrais en revenir à la théorie du chaos, très proche de l’étude des mécanismes économiques, ce que les économistes libéraux admettent d’eux-mêmes, et ce que les marxistes ne peuvent – ou ne veulent – admettre. A voir donc si les dix risques présentés par Nouriel Roubini plongeront l’économie dans une décennie (2020-2030) de désespoir avant que « la technologie et un leadership plus compétent » ne commencent à apporter des solutions à cet état de dépression.
Donc, l’information mainstream nous invite à l’optimisme, affectueusement, maternellement, paternellement. Les taux d’intérêt sont historiquement bas, la planche à billets imprime et imprime encore et l’État étend au-dessus de nos pauvres têtes ses bras protecteurs. Une fois encore, je redoute que cette pandémie ne soit un prétexte pour une ingérence toujours plus poussée de l’État dans la vie de tous. Le secteur privé s’amenuise, la dette (de l’impôt en devenir) est un tsunami, le déficit un maëlstrom, les billets pleuvent au-dessus d’un incendie – ou d’un gouffre ? – et pendant ce temps on discute de transition écologique. Certes, je le redis, la question écologique importe et elle m’importe, mais doit-on fermer des centrales nucléaires maintenant et promouvoir les éoliennes alors que des problèmes d’une extrême gravité nous cernent ? Mais qu’importe, l’argent coule à flot et il est « gratuit ». Quel sera le coût de l’électricité et comment en produira-t-on suffisamment face à une demande sans cesse accrue ? Ce dirigisme est proprement affolant, je pars me consoler chez les libéraux et les libertariens. Il faut limiter l’État à ses fonctions régaliennes ; l’économie n’est en rien son domaine.

Je n’ai pas besoin que l’État régularise mon optimisme ou mon pessimisme. Mes humeurs ne lui appartiennent pas. Pour l’heure, l’information mainstream, diversement phagocytée par l’État, répète à l’envi qu’il n’y a qu’une solution à tous nos maux, la dette, la dette, encore et toujours la dette. On se croirait chez Diafoirus, ce médecin pédant du « Malade imaginaire », mais qui lui au moins avait trois « remèdes » pour tous les maux : des saignées, des purges et des clystères.
L’argent ne pousse pas sur les arbres, disait-on. Non, mais à présent il pleut.
L’État se substitue peu à peu aux entreprises, un dispositif de prise en charge d’un pourcentage élevé du salaire (dispositif dit d’« activité réduite de maintien dans l’emploi ») dans les entreprises affectées par la baisse d’activité est mis en place, sans oublier le dispositif de chômage partiel. De la dette et encore de la dette, avec l’État qui se substitue aux entreprises pour verser des salaires. La France est devenue l’otage de son État, je le répète, ce qui semble ne pas déplaire au plus grand nombre qui plutôt que d’analyser ce qui se passe préfère s’en prendre « aux riches », entendez : « aux plus riches que moi » ; car il n’y a pas de riche dans l’absolu, on est plus riche (pauvre) ou moins riche (pauvre) que d’autres.
Je ne comprends plus rien ou, plutôt, je ne comprends que trop. Nous creusons un gouffre et chantons et dansons la Carmagnole sur son pourtour. Moi qui souffre d’un vertige maladif, je ne participe pas à la fête. Olivier Véran, le ministre de la Santé, est entré dans la danse. Il fait pleuvoir quelques milliards d’euros dans le gouffre sans dire un mot sur d’éventuelles économies qui passeraient non pas par la suppression de lits et de moyens sur le terrain (il faudrait au contraire les augmenter) mais par une restructuration totale de la bureaucratie hospitalière.
Ce n’est pas tout. La France s’est mise à faire la manche, à nous seriner que la mutualisation de la dette est essentielle à la survie de l’Europe. Mais elle ne se soucie toujours pas de mettre de l’ordre dans ses finances publiques, et elle accuse un déficit public toujours plus considérable. A présent, elle gratte à la porte de l’Allemagne en espérant par ailleurs que cette mutualisation se fasse sans condition car il n’est pas question de restructurer l’appareil d’État.
Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent un plan de relance de 500 000 000 000 d’euros. En plus de ce plan de relance, une mutualisation de la dette est prévue ; et les pays bénéficiaires du plan de relance n’auront pas à rembourser (!?) précise Emmanuel Macron qui ne rêve d’amplifier le modèle français à l’Europe. Cet homme est très actif mais son monde est confiné, très confiné.
Les « Frugal four » (« les radins » pour les socialistes) soit l’Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède se sont opposés à un projet de budget européen, puis aux coronabonds, puis au plan de relance. Ils ne voient pas pourquoi les bénéfices de leurs réformes devraient profiter à des États qui manquent de rigueur budgétaire. Ils ont présenté une contre-proposition au plan de relance concocté par la France et l’Allemagne. Cette contre-proposition, une aide d’urgence aux pays les plus touchés (soit essentiellement l’Italie et l’Espagne) sous la forme de prêts ponctuels soumis à conditions. Ils refusent par ailleurs cette proposition d’aide non-remboursable. Je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions et contre-propositions de ces quatre pays, je souhaite simplement que leurs voix l’emportent contre cette Europe normative, technocratique et toujours plus socialiste. Trop d’énergies sont étouffées dans ce magma.
Un excellent article de Natasa Jevtovic, « Doit-on vraiment rembourser la dette publique ? », un article qui met les points sur les i, qui évoque le grand Milton Friedman et qui commence ainsi : « La crise économique qui étouffe la croissance européenne a un nom : c’est une crise de la dette souveraine. Afin de stimuler ou relancer l’économie, les États européens ont mis en œuvre les politiques keynésiennes et dépensé de l’argent public pour aider les secteurs économiques en difficulté. N’ayant pas retenu la leçon tirée de la faillite des économies socialistes à l’Est, les États ont oublié que leur rôle n’était pas d’intervenir dans l’économie mais d’assurer le cadre légal et institutionnel pour faciliter les échanges économiques entre les acteurs privés ». Les États ont oublié que leur rôle n’était pas d’intervenir dans l’économie mais d’assurer le cadre légal et institutionnel pour faciliter les échanges économiques entre les acteurs privés… :
https://www.contrepoints.org/2013/07/31/132870-doit-on-vraiment-rembourser-la-dette-publique
Et pour conclure, un passage extrait de « Harmonies économiques » de Frédéric Bastiat qui répond en quelque sorte à l’exposé que fait Milton Friedman avec son crayon jaune, dans le lien en début d’article :
« Prenons un homme appartenant à une classe modeste de la société, un menuisier de village, par exemple, et observons tous les services qu’il rend à la société et tous ceux qu’il en reçoit ; nous ne tarderons pas à être frappés de l’énorme disproportion apparente. (…) D’abord, tous les jours, en se levant, il s’habille, et il n’a personnellement fait aucune des nombreuses pièces de son vêtement. Or, pour que ces vêtements, tout simples qu’ils sont soient à sa disposition, il faut qu’une énorme quantité de travail, d’industrie, de transports, d’invention ingénieuses, ait été accomplie. Il faut que des Américains aient produit du coton, des Indiens de l’indigo, des Français de la laine et du lin, des Brésiliens du cuir ; que tous ces matériaux aient été transportés en des villes diverses, qu’ils aient été œuvrés, filés, tissés, teints, etc.
Ensuite, il déjeune. Pour que le pain qu’il mange lui arrive tous les matins, il faut que des terres aient été défrichées, closes, labourées, fumées, ensemencées ; il faut que les récoltes aient été préservées avec soin du pillage ; il faut qu’une certaine sécurité ait régné au milieu d’une innombrable multitude ; il faut que le froment ait été récolté, broyé, pétri et préparé ; il faut que le fer, l’acier, le bois, la pierre aient été convertis par le travail en instruments de travail ; que certains hommes se soient emparés de la force des animaux, d’autres du poids d’une chute d’eau, etc. : toutes choses dont chacune, prise isolément, suppose une masse incalculable de travail mise en jeu, non seulement dans l’espace, mais dans le temps. »
Et Frédéric Bastiat poursuit ainsi sur plusieurs paragraphes pour constater ce qui suit : « Il est impossible de ne pas être frappé de la disproportion, véritablement incommensurable, qui existe entre les satisfactions que cet homme puise dans la société et celles qu’il pourrait se donner s’il était réduit à ses propres forces. J’ose dire que, dans une seule journée, il consomme des choses qu’il ne pourrait produire lui-même en dix siècles. »
Après s’être penché sur de « petites choses », comme Milton Friedman avec son crayon jaune, Frédéric Bastiat constate que tous les hommes sont dans le cas de ce menuisier de village, que chacun a « absorbé des millions de fois plus qu’il n’aurait pu produire » et que ce menuisier a pourtant « payé en services tous les services qui lui ont été rendus ». Et Frédéric Bastiat poursuit : « Il faut donc que le mécanisme social soit bien ingénieux, bien puissant, puisqu’il conduit à ce singulier résultat, que chaque homme, même celui qui se sent placé dans la condition la plus humble, a plus de satisfactions en un jour qu’il n’en pourrait produire en plusieurs siècles ». Et fort de cette démonstration, Frédéric Bastiat invite le lecteur à se livrer à cet exercice sur lui-même avant d’ajouter : « On fermerait les yeux à la lumière si l’on refusait de reconnaître que la société ne peut présenter des combinaisons si compliquées, dans lesquelles les lois civiles et pénales prennent si peu de part, sans obéir à un mécanisme prodigieusement ingénieux. Ce mécanisme est l’objet qu’étudie l’économie politique. »
Mais c’est tout le livre, « Harmonies économiques », que je vous invite à lire, si toutefois vous ne l’avez pas lu. Derrière cette petite histoire de crayon jaune avec un Milton Friedman amusé et souriant se tient non seulement la silhouette d’Adam Smith qu’il évoque mais aussi celle de Frédéric Bastiat, un géant de la pensée économique, très étudié dans le pays de Milton Friedman mais inconnu ou boudé dans son pays, la France, pour des raisons dans lesquelles je n’entrerai pas mais qui sont exclusivement politiques, idéologiques.
Olivier Ypsilantis