Tableau XXXV – “Everyone carries a part of society on his shoulders; no one is relieved of his share of responsibility by others. And no one can find a safe way out for himself if society is sweeping toward destruction. Therefore, everyone, in his own interests, must thrust himself vigorously into the intellectual battle. None can stand aside with unconcern; the interest of everyone hangs on the result. Whether he chooses or not, every man is drawn into the great historical struggle, the decisive battle into which our epoch has plunged us.” Ludwig von Mises.
Tableau XXXVI – On a tendance à considérer Adam Smith (1723-1790) comme étant à l’origine de la science économique. C’est aller un peu vite en besogne. Les lointains fondateurs de la science économique n’étaient pas des économistes au sens propre du mot mais des théologiens moraux qui s’inscrivaient dans la tradition de saint Thomas d’Aquin, connus comme les scolastiques tardifs. Ces hommes qui ont professé en Espagne étaient au moins aussi favorables au libre marché que le sera la tradition écossaise. Leur base théorique était particulièrement solide.
 Vue d’ensemble de la bibliothèque historique de l’Université de Salamanque
Vue d’ensemble de la bibliothèque historique de l’Université de Salamanque
Au XVIe siècle, l’Espagne et le Portugal (entre 1580-1640, le Portugal a été annexé par l’Espagne) explorent le monde et deviennent les centres mondiaux du commerce et de l’économie. Les universités espagnoles, à commencer par celle de Salamanque (Salamanca), œuvrent à un renouveau du projet scolastique, soit, fort des traditions chrétiennes, investir toutes les sciences, y compris l’économie, en prenant appui sur la raison et le droit naturel, des idées universelles à partir desquelles définir des lois universelles qui régissent la marche du monde. L’économie n’est certes pas encore envisagée comme une discipline à part entière ; pourtant ces savants sont conduits au raisonnement économique comme étant l’un des moyens d’appréhender le monde. Ils cherchent des régularités dans l’ordre social et font reposer les normes catholiques de justice sur ces régularités. Parmi ces hommes, citons : Francisco de Vitoria, Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias et Luís de Molina.
Tableau XXXVII – La spécificité de la dette publique doit être envisagée à partir des principes du crédit, en général. Dans ce qui est bien une relation commerciale, un créancier transfert une somme à un débiteur qui en a un usage immédiat, en échange de quoi ce débiteur s’engage à verser à terme (à définir) une somme équivalente plus un intérêt destiné à dédommager le créancier. Murray Rothbard fait remarquer que si un débiteur privé est en défaut, il ne s’agit pas seulement d’une question économique mais aussi (et d’abord pourrait-on dire) d’une atteinte à la propriété du créancier, considérant que la propriété qui lui était promise (le remboursement de l’intégralité de la somme prêtée plus les intérêts selon une échéance précise) ne lui est pas transférée. C’est pourquoi les Anciens condamnaient parfois (très) durement ce défaut. La chose s’est adoucie mais les individus honnêtes voient leurs dettes comme des engagements sacrés.
Le problème est que cet arrangement entre particuliers ne peut être appliqué à la dette publique puisque le créancier et le débiteur passent un contrat sur le bien – sur le dos – d’un tiers, le contribuable. Et l’État rembourse sa dette avec le produit des impôts. Le créancier et le débiteur sont donc complices, ce qui n’est jamais le cas entre particuliers. Les membres de l’appareil d’État peuvent déclarer qu’ils ont été élus – tout au moins par une majorité – et qu’en conséquence ils ont carte blanche. D’un point de vue libertarien, la dette publique ne saurait avoir la même légitimité que la dette privée, un point de vue que je partage pleinement. Le rapport d’individu à individu (deux propriétaires légitimes) est « sacré ». Avec l’État – et ses gouvernements successifs – on ne peut avoir les mêmes scrupules.
Tableau XXXVIII – Le socialisme séduit d’autant plus que chacun peut placer dans son sac et sortir de son sac ce qu’il veut. J’ai toujours eu un rapport quasi physique aux mots et le mot « socialiste » m’est particulièrement désagréable, je m’en méfie. Il est entré dans tant de dénominations, à commencer par nationalsozialismus, qu’il ne ressemble plus à rien. C’est un fourre-tout, un sac informe capable de prendre toutes les formes. Je ne vais pas remuer une fois encore cette question mais enfin, Adolf Hitler comme François Hollande se déclaraient socialistes. Bien sûr, il ne s’agit pas de comparer un homme qui a mis l’Europe à feu et à sang avec un Père la Pantoufle, véritable personnage de vaudeville, mais les mots ont un sens précis et certains ne désignent plus rien à force d’avoir voulu et de vouloir encore trop désigner. Le sujet est clos.
Le socialisme a échoué et échouera ; sa nature même explique les raisons de son échec – et non le degré avec lequel il est appliqué. Ma dénonciation du socialisme s’opère aussi d’un point de vue libéral par lequel je m’efforce de montrer en quoi les idées qui sous-tendent le socialisme sont incompatibles avec les principes d’une société libre. Le socialisme peut être différencié du libéralisme à partir de la distinction collectivisme / individualisme.
Le socialisme envisage la société comme de l’argile, comme de la pâte à modeler : on la pétrit à sa guise pour en retirer ce qui semble être le meilleur – qui est souvent le pire. Le libéral (l’individualiste) laisse la société suivre son cours, avec ses imprévus.
L’égalité peut être conçue selon deux perspectives : l’égalité face à la loi et l’égalité des résultats. L’égalité face à la loi est l’un des fondements du libéralisme : chaque individu est égal devant la loi, point à la ligne. L’égalité des résultats suppose une intervention forte dans les processus de la vie sociale puisqu’il s’agit de défendre des modèles – un plan –, modèles promus par les détenteurs du pouvoir, qu’ils soient issus d’élections démocratiques ou d’un coup d’État. Le socialisme place la collectivité au-dessus de l’individu qui est diversement sanctionné s’il ne fait pas preuve de docilité.
Certes, vouloir anticiper les activités d’un groupe n’est pas répréhensible en soi. Le problème porte sur les moyens d’y parvenir. Les libéraux peuvent proposer la mise en place d’institutions et d’un cadre légal à même d’offrir aux individus et aux groupes la possibilité d’organiser leurs activités. Mais les socialistes ne s’en tiennent pas à cette proposition, ils ont en tête de réaliser un objectif politique défini à l’aide d’une direction centralisée – étatisée – de l’ensemble de l’activité économique.
L’échec du planisme (cette théorie économique élaborée au cours des années 1930 et qui considère qu’un plan peut modifier la société dans le « bon sens ») s’explique par l’absence de mécanisme lisible de fixation des prix. Sans concurrence ni correction constante des prix par l’offre et la demande, comment déterminer le coût et le rendement d’une activité ? L’offre et la demande se trouvent alors en constant disfonctionnement l’une envers l’autre.
C’est aussi pourquoi le socialisme mène à l’embourbement et à l’arbitraire au nom des idées, du plan. C’est un pouvoir exorbitant donné à la collectivité qui, de fait, se voit dirigée par une minorité qui prétendant parler au nom de tous ne parle qu’en son nom, au nom de ses intérêts de caste, au nom des membres de l’appareil d’État.
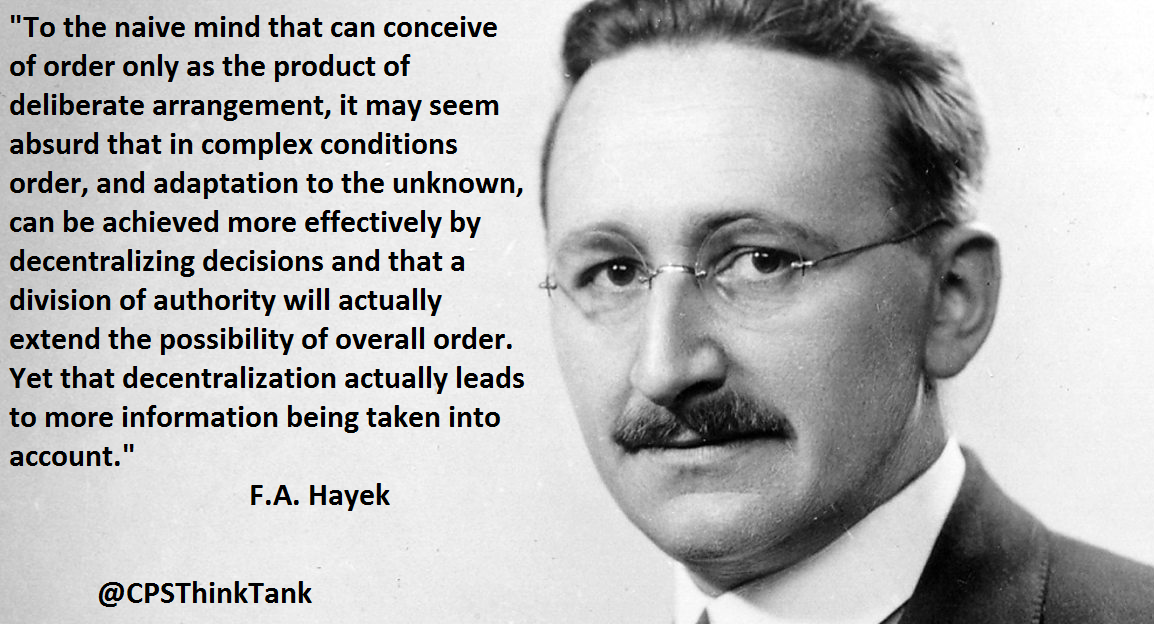
Tableau XXXIX – Le Cato Institute présente ainsi l’œuvre de Friedrich Hayek : « “It is hardly an exaggeration to refer to the twentieth century as the Hayek century,” John Cassidy wrote in the New Yorker. The Cato Institute was proud to count him as a distinguished senior fellow. We provided support for Hayek’s research in his later years, during which he wrote “The Fatal Conceit: The Errors of Socialism” and lectured around the world. The Cato Institute’s auditorium is named for him. Hayek won the Nobel Prize in Economics in 1974 for his “pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena.”
Hayek may have made his greatest contribution to the fight against socialism and totalitarianism with his best‐selling 1944 book, “The Road to Serfdom”. Hayek warned that state control of the economy was incompatible with personal and political freedom and that statism set in motion a process whereby “the worst get on top.” But not only did Hayek show that socialism is incompatible with liberty, he showed that it is incompatible with rationality, with prosperity, and with civilization itself. His essay “The Use of Knowledge in Society”, published in the American Economic Review in 1945 and reprinted hundreds of times since, is essential to understanding how markets work.
Building on his insights into how order emerges “spontaneously” from free markets, Hayek turned his attention after the war to the moral and political foundations of free societies. The Austrian‐born British citizen dedicated his classic “The Constitution of Liberty” “To the unknown civilization that is growing in America.” Hayek had great hopes for America, precisely because he appreciated the profound role played in American popular culture by a commitment to liberty and limited government. While most intellectuals praised state control and planning, Hayek understood that a free society has to be open to the unanticipated, the unplanned, the unknown. As he noted in “The Constitution of Liberty”, “Freedom granted only when it is known beforehand that its effects will be beneficial is not freedom.” The freedom that matters is not the “freedom” of the rulers or of the majority to regulate and control social development, but the freedom of the individual person to live his own life as he chooses. The freedom of the individual to break old molds, to create new things, and to test new paths is the mark of a progressive society: “If we proceed on the assumption that only the exercises of freedom that the majority will practice are important, we would be certain to create a stagnant society with all the characteristics of unfreedom.”
Although sometimes characterized by his critics as a “conservative,” Hayek always maintained that he was in fact an old‐fashioned liberal, a believer in individual liberty, constitutionally limited government, and the free market of ideas and of goods. A progressive society must always be open to innovation, he said, at the same time that it rests on a stable foundation of rights and rules of just conduct. He entitled the postscript to “The Constitution of Liberty” “Why I am not a conservative.” »
Olivier Ypsilantis