Durant l’Occupation, Liliane Lurçat est exemptée du port de l’étoile jaune car palestinienne et donc British Subject. Liliane Lurçat est née à Jérusalem en 1928. Elle est venue en France avec sa famille au cours de l’hiver 1930, une famille originaire de Pologne, Cracovie pour le père et de Russie, Bialystok pour la mère.
Elle s’inscrit à la Fédération sportive et gymnastique du travail, F.S.G.T., créée en 1934, sous le Front populaire, par fusion de la Fédération sportive du travail, F.S.T. (proche de la Confédération générale du travail unitaire, C.G.T.U.) et de l’Union des sociétés sportives et gymniques du travail, U.S.S.G.T. (proche de la Confédération générale du travail, C.G.T.). Le compte-rendu de ses activités à la F.S.G.T. occupe plusieurs pages de la deuxième partie de ce livre, « La guerre », avec des randonnées en forêt de Fontainebleau et les amitiés qu’elle y noue ou une marche de Niort à Nantes. Elle passe à côté de la Résistance et de la peur. N’ayant jamais été malade ni éprouvé la fatigue ou la douleur, la mort et la destruction de son corps lui semblent irréelles. Et, une fois encore, elle n’a pas à subir l’étoile jaune – « Je me réjouis lâchement de ne pas avoir à la porter » –, à subir non seulement la honte mais, ce qui est pire, la honte d’avoir honte.
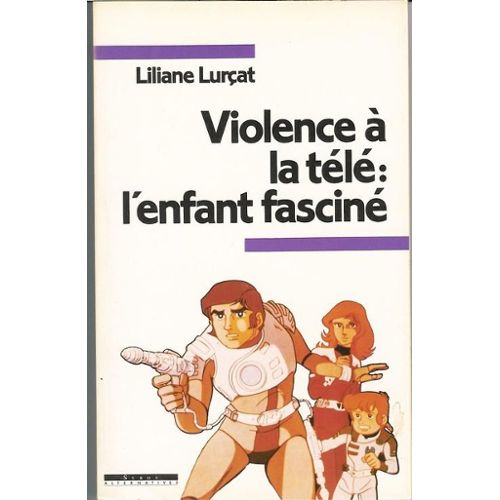
Avant de poursuivre la lecture de ses souvenirs, j’en reviens au rire. L’un des livres qui m’a fait le plus rire est « La trêve » (« La Tregua ») de Primo Levi. Son cadre est pourtant celui de la dévastation ; mais la coloration de l’ensemble est franchement picaresque, de la libération d’Auschwitz au très long et très tortueux retour au pays, l’Italie. C’est toute une humanité qui se retrouve pêle-mêle et qui se débrouille dans un monde chaotique et déglingué mais tellement merveilleux après Auschwitz. Ce livre qui se lit comme on regarde un film a une tonalité proche du « Tambour » (« Die Blechtrommel ») de Günter Grass et de son extraordinaire adaptation au cinéma signée Volker Schlöndorff. Ce livre est d’autant plus hilarant – il m’a lui aussi offert des fous rires – que sa lecture fit suite à une lecture qui m’avait ôté le sommeil : « Si c’est un homme » (« Se questo è un uomo ») de Primo Levi.
Il y a décidément dans ce petit livre de Liliane Lurçat une acuité du regard qui le rapproche des caricaturistes, soit l’art de souligner les traits physiques et psychologiques les plus marquants d’un individu. Et les portraits qu’elle fait défiler en quelques coups de crayon alertes sont hauts en couleurs. Les portraits de ses parents sont des petits chefs-d’œuvre qui intègrent le physique, le psychologique et le sociologique, un peu comme Honoré Daumier.
Je ne connais pas les écrits de Liliane Lurçat (hormis quelques articles mis en ligne) mais son regard est aussi sociologique. Elle n’est pas froidement universitaire, soit simplement besogneuse et obéissant à des normes instituées par la hiérarchie et l’esprit de l’époque. Non ! Son esprit d’indépendance, voire rebelle, lui fait sauter l’enclot. C’est un regard sérieux, très sérieux, mais sous-tendu par le sourire, un sourire triste-amusé pourrait-on dire. Et puis cette femme a du style, ce qui suffit à la démarquer de bien des universitaires, tout simplement.
Mais à quoi tient ce style, cette tonalité particulière de la langue ? Hier soir, une impression m’a sauté à la gorge si je puis dire ; et une récente rencontre m’a aidé à la préciser, une rencontre avec une grande dame des lettres italiennes, dans son appartement romain, rencontre organisée par sa traductrice. Cette grande dame : Edith Bruck à laquelle j’ai consacré neuf articles sur ce blog.
Edith Bruck (née Edith Steinschreiber), juive hongroise devenue italienne après bien des tribulations, notamment en Israël. Déportée à Auschwitz à l’âge de douze ans, elle ne reviendra jamais vivre dans son pays.
Il y a chez Edith Bruck une manière de rapporter certaines expériences qui frappe le lecteur par leur crudité, ce qui ajoute à l’attrait puissant qu’elle exerce sur le lecteur. J’ai pensé que cette liberté de ton plutôt inhabituelle chez une femme de cette génération tenait au moins en partie à ce que l’italien n’était pas sa langue maternelle ; elle se sentait plus libre en elle, plus audacieuse. Un jour, sa traductrice, Patricia Amardeil, me fit part de cette impression alors que je ne lui avais encore rien dit à ce sujet. J’évoque Edith Bruck car je crois percevoir le même processus, en plus atténué, chez Liliane Lurçat ; sous le français on sent quelque chose d’autre, comme une lumière translucide derrière une vitre dépolie ; ce quelque chose, une autre langue, sa langue maternelle, le yiddish, la langue commune de ses parents polyglottes. Certes, cette liberté de ton tient d’abord au caractère de l’auteure, mais le yiddish vient appuyer cette liberté. Pour ma part, très modestement, je ne connais que quelques dizaines de mots yiddish, des injures pour la plupart, des injures truculentes et réjouissantes qu’il m’arrive d’insérer dans un texte, des injures dont je me retiendrais d’écrire l’équivalent en français (un équivalent bien approximatif) mais que j’ose en yiddish et qui me donne l’impression de frapper en plein dans le mille. Pareillement, lorsque je veux terminer une lettre sur une formule affectueuse, à une amie française par exemple, je choisis une formule dans une autre langue ; ainsi je me sens plus libre en gommant le côté équivoque que pourrait avoir son équivalent en français. Ces procédés sont connus de tous ceux qui pratiquent plusieurs langues.

Parmi les proches que Liliane Lurçat évoque avec ferveur, il y a ses parents, Chaya et Joseph Kurtz, mais aussi le frère aîné, Menahem, qui eut la chance d’être intégré dans un échange entre British Subjects et prisonniers allemands en Palestine. Ce frère avait dix-sept. Il deviendra un ardent défenseur d’Israël.
Liliane Lurçat est arrêtée en janvier 1944. Sa déportation marque un tournant dans sa vie : Drancy qu’elle qualifiera d’« école de la vie » puis Vittel où elle est libérée en octobre 1944. Deux de mes ancêtres côté maternel furent internés à Vittel en tant que Grecs British Subjects. Je me suis d’abord dit qu’ils avaient peut-être rencontré Liliane Lurçat mais la période de leur internement était bien antérieure, 1941-1942.
La remarque de Liliane Lurçat me remet en mémoire celle de Primo Levi : « Ma vraie université, ce fut Auschwitz ». Un ami rescapé d’Auschwitz, un Juif ashkénaze qui aimait le paradoxe et qui maniait l’euphémisme avec un art consommé, me dit un jour tout de go : « Si je n’avais pas connu Auschwitz, je me serais peut-être ennuyé » ; et un autre jour : « On s’occupait beaucoup de nous à Auschwitz », une réflexion qui révéla d’un coup le gouffre sous le verbe s’occuper de, sa terrible ambiguïté à laquelle nous ne prêtons généralement guère attention.
Liliane Lurçat reste environ trois mois à Drancy avant d’être envoyée avec trois cents Palestiniens (Juifs de Palestine) à Vittel, à l’hôtel des Thermes. S’en suit une analyse très fine de l’amour qui pourrait faire l’objet d’un long développement, d’un livre. Retour à Paris à bord de camions conduits par des Noirs américains. Retour dans le petit appartement de la rue Frédéric Sauton aux numéros 5-7, dans le Ve arrondissement de Paris. Elle a seize ans. Le quartier n’est pas ce qu’il deviendra. Il est plutôt crasseux. La rue Frédéric Sauton « entre la place Maubert et la Seine. Au fond d’une cour, au premier étage, une cuisine et deux pièces en enfilade. Les cabinets sont dans la cour et l’eau sur le palier. Il n’y a jamais de soleil ». Liliane Lurçat reprend ses études. Elle est un peu perdue, déconcertée. Ses professeurs l’ennuient, ce qui nous vaut quelques croquis exécutés d’un trait sûr et sobre. Elle est bachelière « presque par surprise » et s’inscrit en PSB (Physique, Chimie, Biologie) mais se sent incapable de suivre cet enseignement, tant dans les amphithéâtres qu’aux travaux pratiques. Elle entend des étudiants parler de sociologie à la Sorbonne. L’année est perdue mais, c’est décidé, elle s’inscrira en sociologie.
Inscrite en sociologie, elle passe ses soirées à la bibliothèque et découvre les travaux de Henri Wallon qui contrairement aux autres psychologues ne découpe pas artificiellement les petits problèmes, nous dit-elle. Henri Wallon, une rencontre déterminante.
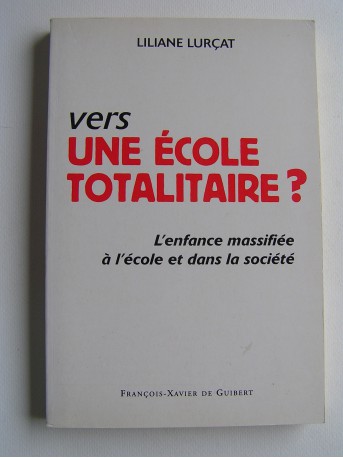
Ci-joint, un passage relevé dans la première partie du livre. Il rend bien compte de ce pur plaisir que donne l’observation, surtout lorsqu’elle est neutre, ne s’embarrasse ni de jugements et de conclusions qui ne font que découper en morceaux une réalité donnée. Il s’agit de son voisinage parisien : « Pépère n’est pas méchant, mais un peu répugnant. Il a des moustaches blanches comme Pétain, et les mêmes yeux bleus délavés. Il passe le temps à faire le frichti. On lui a rapporté d’énormes grenouilles. Il les coupe en deux et il jette le haut des corps dans un seau. Ses mains sont toutes vieilles et tremblantes. Un jour, il a voulu m’embrasser. J’ai couru vite dans l’escalier et mon cœur battait fort. Il est comme beaucoup d’hommes vieux et ternes qu’on appelle les vicieux. Certains défont leurs braguettes devant les petites filles qui jouent seules au square. D’autres, comme le voisin de palier, font pipi dans l’évier et vous appellent à ce moment-là. Je ne sais pas juger les gens. Ils laissent en moi des impressions et des images. Une phrase dite, une intonation, un geste et surtout des odeurs. »
Je ne sais pas juger les gens. Ils laissent en moi des impressions et des images. Une phrase dite, une intonation, un geste et surtout des odeurs…
On n’a qu’un regret en lisant ce petit livre : qu’il n’ait pas une suite même s’il se termine sur un happy end : elle a fait la connaissance de Henri Wallon qui lui a dit qu’elle était intelligente et d’un poète, Nazim Hikmet, qui lui a dit qu’elle était belle. « Que me manque-t-il ? »
On n’a qu’un regret en lisant ce petit livre mais on oublie vite ce regret car cette lecture laisse une impression persistante, avec cette composition en mosaïque où se suivent des passages qui se suffisent à eux-mêmes et suggèrent volontiers de longs développements : portraits précis et rapides de toute une humanité ; descriptions de lieux, avec le vieux Paris, soit son quartier du Ve arrondissement ; remarques à caractère psychologique et sociologique qui par leur finesse m’évoquent des moralistes du XVIIIe siècle et des romanciers du XXe siècle. Sous une certaine rudesse de ton, on devine la tendresse, une tendresse portée par le plaisir d’observer, le simple plaisir d’observer, le plus simple et le plus grand – le plus vaste – des plaisirs, un plaisir qui peut être pratiqué toujours et partout. Mais ils ne sont pas nombreux à observer, de moins en moins nombreux me semble-t-il, avec leurs téléphones portables à écrans tactiles.
Olivier Ypsilantis