En Header, la mère de Pierre Lurçat, Liliane Lurçat, née Lipah Kurtz.
J’ai reçu par le courrier deux livres envoyés par Pierre Lurçat : « Un parapluie pour monter jusqu’au ciel – Souvenirs de jeunesse » de Liliane Lurçat, sa mère récemment décédée, et « Vis et ris ! » de Pierre Lurçat, un livre qu’il dédie à sa mère. J’ai décidé de commencer par le livre de la mère et de ne pas ouvrir le livre du fils avant de l’avoir terminé. Je ne veux pas qu’il y ait la moindre interférence. Je lirai et rendrai compte du livre de Pierre Lurçat après et ainsi reviendrai-je à la mère guidé par le fils.

« Un parapluie pour monter jusqu’au ciel » est un livre de souvenirs (de jeunesse) dont l’histoire nous est rappelée par Pierre Lurçat, en dernière page. C’est un livre écrit on ne sait quand, un livre dont les manuscrits et la version tapée à la machine sont restés dans un placard durant plusieurs décennies. « Souvent, quand elle me racontait des histoires datant de sa jeunesse, je lui disais qu’elle devrait écrire ses mémoires, sans me douter qu’elle l’avait déjà fait ».
Liliane Lurçat (1928-2019) est l’auteure de nombreuses publications relatives à sa spécialité, la pédagogie. Peut-être a-t-elle jugé que ses souvenirs étaient futiles en regard de ses écrits professionnels. Mais qu’importe ! Ce qui importe c’est que son fils Pierre et sa fille Irène aient secouru ces feuillets et les ai publiés, nous donnant ainsi à lire un petit livre qui relate non seulement son histoire et celle de sa famille, mais aussi celle d’une époque déjà lointaine.
Ce livre se lit d’une traite. Mais on se retient de le lire ainsi pour… faire durer le plaisir. C’est un livre écrit d’une plume alerte, espiègle. En quelques lignes un portrait physique/psychologique est planté, ce qui donne des portraits-charges voire des caricatures. J’ai souri plus d’une fois en lisant ce livre. Je lui ai même trouvé par moments un côté BD, avec cette écriture illustrative. La BD ! Ce n’est pas amoindrir la qualité de ce document que de comparer certaines de ses séquences à de la BD, et la meilleure. On peut imaginer une planche ou des planches à partir du passage suivant : « Mon frère aîné est gros et indolent. Il lit sans arrêt. Quand il ne lit pas, il s’achète des livres. Il lit en mangeant et la mère en profite pour remplir son assiette, c’est ce qui le fait grossir ». Des passages dans ce genre, il y en a beaucoup dans ce livre.
Il y a dans ces pages un regard yiddish, soit une manière de regarder le monde, sa médiocrité et sa saleté, avec un certain amusement, non pour se placer au-dessus de lui et le dédaigner mais pour le rendre supportable. Je risque cette supposition et j’en saurai probablement plus lorsque je lirai le livre écrit par le fils.
Ce petit livre témoigne d’une époque à Paris. Il m’a reporté dans le souvenir d’une lecture, à ma connaissance le plus beau livre de témoignage sur Paris, Paris fin XIXe siècle – début XXe siècle, un authentique trésor : « Pierre-Auguste Renoir, mon père » de Pierre Renoir.
J’ai été pris de fous rires en lisant ces souvenirs de Liliane Lurçat. Ma femme m’a demandé ce qui me faisait rire ainsi, je lui ai lu quelques passages, elle s’est mise à rire, rire de mon rire mais aussi de ces tableaux, véritables caricatures qui par leur truculence et leur tendresse m’évoquent d’un coup le grand Albert Dubout. J’y pense ! Albert Dubout aurait probablement illustré ce livre avec un grand plaisir. Souvenez-vous du Petit Train de Palavas-les-Flots, de toute cette humanité sympathique, diversement grotesque et qu’on ne se lasse pas d’observer.
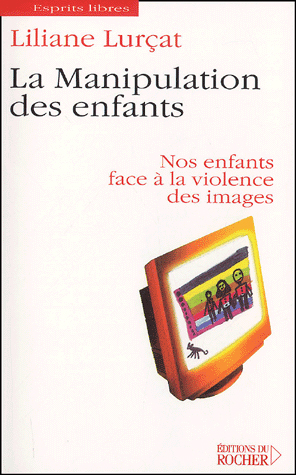
Liliane petite fille va au cinéma avec toute une équipe, des membres de sa famille : « Tous les spectacles sont bons, pourvu qu’il y ait de l’image. Quatre heures d’affilée et l’on sort avec la tête comme ça ». Et en sortant du cinéma, la petite fille fait ce que nous avons tous fait, nous prendre pour l’un des acteurs ou l’une des actrices : « La volonté, ça se reconnaît à la façon de serrer la main : une poignée de main énergique. Je serre la main de toutes mes forces. Dans le métro, je fronce le sourcil pour montrer que j’ai moi aussi des préoccupations ». Bref, il y a de la moquerie dans ces pages, une moquerie amusée (jamais acerbe), de la dérision (non exempte de tendresse), de l’autodérision, beaucoup d’autodérision, de l’insolence et bien d’autres choses. De l’insolence ? Mais qui n’en a pas : « J’ai une réputation : celle de “répondre”, ce qui est naturel quand on vous adresse la parole, d’être insolente, ce qui est une façon de dire la vérité ».
Certains passages sont des morceaux d’anthologie, par exemple : « En français les rapports avec les autres sont plus objectifs. Il y a l’autre langue, le yiddish, la langue de la maison. Celle où l’on se rudoie parfois, celle de la petite enfance et aussi des choses ennuyeuses, les ordres contre lesquels on se rebiffe d’instinct. Le démarquage linguistique accuse et rend plus étouffante la famille et ses contraintes. Les rapports y sont trop affectifs, on est trop les uns sur les autres ». De fait, des remarques placées ici et là laissent entrevoir les travaux que mènera Liliane Lurçat tout au long de sa carrière. La liste de ses publications est consultable en ligne. Je propose l’article suivant, publié dans son intégralité et qui suggère l’amplitude et la profondeur de l’aire explorée par Liliane Lurçat. On pourra prendre note de l’acuité de son regard et de son « impertinence » avec « Le pédagogisme facteur d’échec » :
https://www.sauv.net/lurcat1.htm
Je poursuis donc la lecture de cette première partie. Je me retrouve en compagnie de toute une humanité qui passe dans un joyeux chahut – et je pourrais en revenir à Albert Dubout : « Une dame, toujours épuisée, maigre et misérable, elle a deux petites filles rousses et frisées qu’elle gave tellement qu’elles en sont devenues énormes et un peu repoussantes… Elle est malade, dit la mère, sa maladie c’est de ne pas pouvoir péter, alors les gaz restent en elle et l’empoisonnent ». Il est assez souvent question de gens qui s’empiffrent, deviennent gros et… peu appétissants. Ces pages au style alerte et amusé peuvent également trouver leur équivalent dans l’imagination du lecteur avec des photographies de Robert Doisneau, d’Édouard Boubat ou de Willy Ronis, un Ashkénaze lui aussi et qui a dit Paris comme peu l’ont dit.
Je me perds en références mais pas tant car cette lecture ne cesse de faire venir et revenir en moi des images. Ainsi, mentalement, j’illustre ce petit livre sans image mais qui, à sa manière, est une suite d’images, dessins ou photographies, mais aussi de séquences filmées.
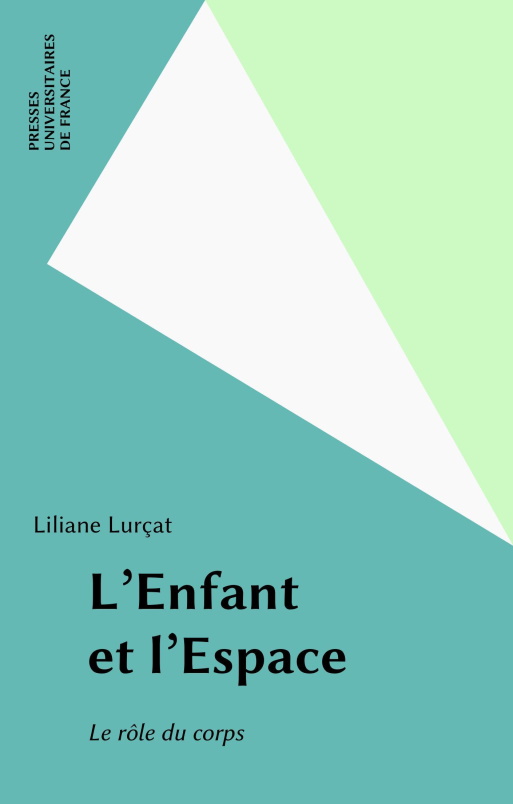
Il y a les voisins de l’immeuble, parmi lesquels Bernard (l’ami de Sami, le petit frère de Liliane Lurçat) et sa famille. Bernard lui aussi ne cesse de manger. Il dévore tout ce qu’il trouve, par exemple les harengs avec la tête, et boit le vinaigre au goulot. Sa famille mange « en faisant un bruit incroyable et à une vitesse prodigieuse ». Quant aux voisins du dessus, une autre famille juive, ils travaillent à domicile, ce sont des tricoteurs dont les deux machines font vibrer les murs et jusqu’à une heure avancée de la nuit. Le père de Liliane s’énerve, monte leur expliquer en yiddish qu’on n’est pas sur terre que pour travailler. Bref, les Juifs travaillent trop et les Français sont des poivrots. Presque tout le monde picole, surtout celle qui loge dans le grenier et qui boit plus que tous les autres réunis. Elle est femme de ménage à la halle aux vins et en fin de mois elle a droit à une caisse de Ricard à un prix très réduit. Liliane observe le monde des adultes, plutôt grotesque ; et elle se console (on sent sourdre l’ironie) en lisant des livres d’histoire qui célèbrent le Progrès.
A la fin de la première partie (il y en a trois), l’auteure nous livre une clé de sa psychologie. De fait, elle contribue à donner à ces pages une tonalité particulière, unique : « Je ne sais pas juger les gens. Ils laissent en moi des impressions et des images. Une phrase dite, une intonation, un geste et surtout des odeurs ». Suit une longue énumération d’odeurs, à commencer par celle des hommes et des femmes car chacun(e) a la sienne.
La petite fille filme, photographie ; elle observe, ce qui suppose un certain recul ; elle est néanmoins abrutie par les êtres et par leur seule présence, « une somme complexe d’une foule de petites choses qui les font eux ». Mais vient le moment où il faut se réinvestir : « Et le verbe devient agressif, et la critique impitoyable. Je me récure de l’autre, au prix de sa destruction ». Je connais fort bien ce processus pour l’avoir beaucoup expérimenté dans ma jeunesse, et de moins en moins avec la maturité.
(à suivre)
Olivier Ypsilantis
Le commentaire de ce livre se lit avec un plaisir immense et donne envie de courir acheter ces mémoires et de s enfoncer dans ce récit teinté d humour .
J attends avec impatience le compte rendu du livre du fils.