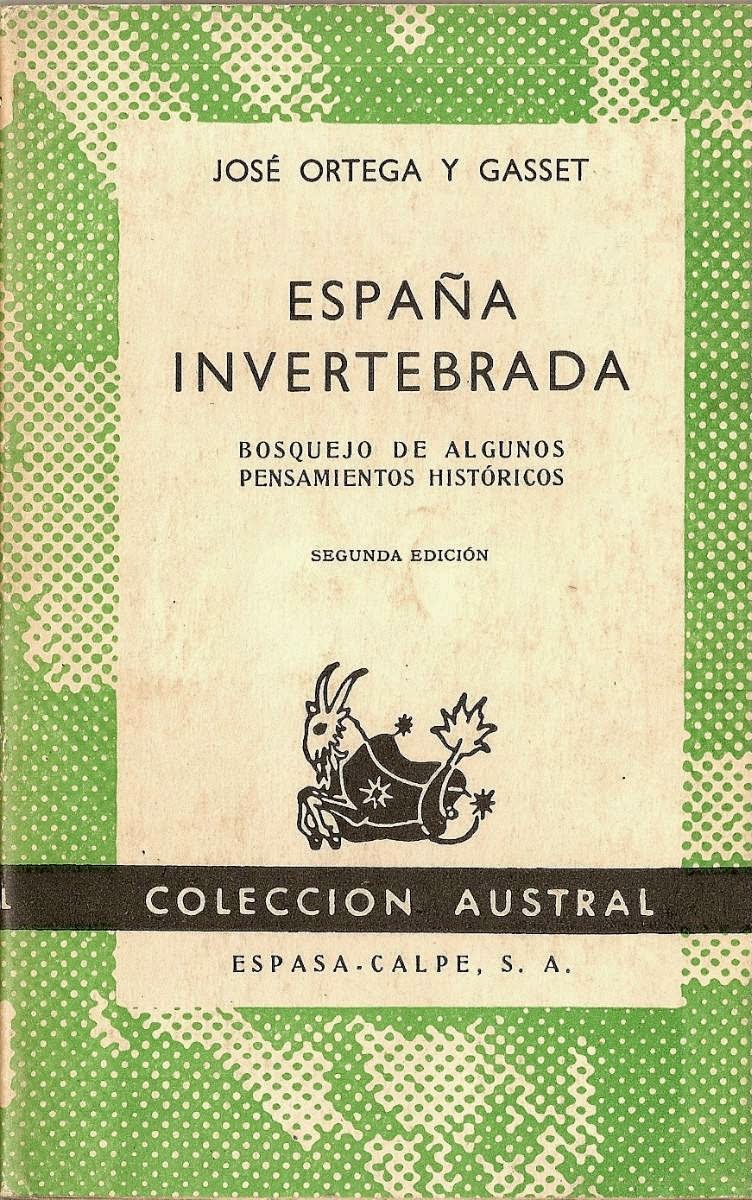 La merveilleuse Colección Austral (Espasa-Calpe, S.A.)
La merveilleuse Colección Austral (Espasa-Calpe, S.A.)
Je propose ci-joint une esquisse de traduction de deux petits textes de José Ortega y Gasset respectivement intitulés : « El quehacer del hombre » et « Concepto de la historia » (inclus dans « Historia como sistema »), deux textes particulièrement représentatifs de la pensée de l’auteur de « La rebelión de las masas » et enregistrés par El Centro de Estudios Históricos, le 30 juin 1932 :
I – El quehacer del hombre (esquisse de traduction).
La vie est ouvrage (quehacer) et la vérité de la vie, c’est-à-dire la vie authentique de chacun d’entre nous, consistera à faire ce qu’il y a à faire en évitant de faire n’importe quoi (evitar el hacer cualquiera cosa). A mon sens, un homme vaut dans la mesure où l’ensemble de ses actes sont nécessaires et non soumis au caprice. D’où la difficulté de l’entreprise. On a l’habitude de nous présenter comme nécessaires des actes que d’autres ont accomplis et qui nous parviennent auréolés de prestige. C’est ce qui nous incline à nous trahir (a ser infieles con nuestro auténtico quehacer, que es siempre irreductible al de los demás). La vrai vie s’invente, irrémédiablement (inexorablement). Nous devons inventer notre propre existence (vida verdadera, auténtica — existencia) mais sans jamais nous laisser guider par le caprice. Le mot « inventer » se ré-approprie ainsi son sens premier qui est « trouver ». Nous devons trouver (hallar), découvrir le sens (trayectoria necesaria) de notre vie ; et ce n’est qu’à ce prix qu’elle sera vraiment nôtre et non celle d’un autre (de n’importe qui) ou de personne (de n’importe qui) comme l’est celle du frivole.
Comment répondre à une question si difficile ? Pour ma part, elle ne m’a jamais posé problème. On se retrouve dans la situation d’un poète auquel on impose un pied forcé. Ce pied forcé est la circonstance (Circunstancia, concept fondamental chez José Ortega y Gasset, et peut-être le mot qui revient le plus souvent sous sa plume. « Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo » note-t-il dans « Meditaciones del Quijote »). A aucun moment de notre vie nous n’échappons à une circonstance particulière et incontournable. C’est elle qui nous présente idéalement (ideal perfil) ce qu’il y a à faire (ce que nous avons à faire).
Je me suis efforcé de répondre à cette exigence dans mon travail. J’ai accepté les aléas (circunstancias) imposés par mon pays et mon époque. L’Espagne souffrait et souffre encore d’un déficit (mot en français dans le texte) d’ordre intellectuel. Elle avait perdu la dextérité (destreza) dans le maniement des concepts qui sont — ni plus ni moins — les instruments à l’aide desquels nous nous dirigeons au milieu des choses. Il fallait lui apprendre (à cette dextérité perdue) à affronter la réalité et à la transmuter en pensée, le plus pleinement possible. Il s’agit d’une affaire plus ample que la science, la science n’étant qu’une manifestation parmi tant d’autres de la capacité humaine à réagir intellectuellement face au réel.
Cette tentative d’apprentissage intellectuel, il fallait s’y livrer là où était l’Espagnol : dans la conversation amicale, par les journaux et les conférences. Il fallait l’inviter (l’Espagnol) à l’exactitude de l’idée par la grâce de la tournure. En Espagne, il faut d’abord séduire pour persuader.
II – Concepto de la historia (esquisse de traduction).
Je parle depuis El Centro de Estudios Históricos et je profite de ce moment et de l’endroit où je me trouve pour exprimer mon enthousiasme et ma foi en l’Histoire. L’Histoire est aujourd’hui pour l’Europe la condition primordiale à son éventuel assainissement et à sa ré-émergence. Chacun d’entre nous ne possède que ses propres vertus et non celles de l’autre. L’Europe est vieille et ne peut prétendre aux vertus des jeunes. Sa vertu est la vieillesse, à savoir une vaste mémoire, une vaste Histoire. Les problèmes que génère sa vie sont hautement compliqués et ils exigent des solutions elles aussi très compliquées que seule l’Histoire peut apporter. Autrement dit, il y aurait un anachronisme entre la complexité de ses problèmes et la simplicité juvénile et dénuée de mémoire des solutions qu’on voudrait leur apporter. L’Europe doit apprendre de l’Histoire sans chercher à trouver en elle une norme qui la guiderait — l’Histoire ne prévoit pas l’avenir —, elle doit apprendre d’elle ce qu’elle doit éviter de faire ; autrement dit, à renaître constamment d’elle-même en évitant le passé. Ce à quoi nous sert l’Histoire : nous libérer du passé, car le passé est un revenant (mot en français dans le texte) ; et si on ne le domine pas par la mémoire en le nettoyant (refrescándole), il revient toujours se plaquer contre nous et finit par nous étouffer. Telle est la foi et tel est l’enthousiasme que je mets en l’Histoire ; et c’est avec une ferveur toute espagnole que je prends note en ce lieu de l’attention portée au passé, une manière de le rendre fécond comme le soc de l’araire rend la vieille terre féconde.
____________________
Parmi les guides qui font merveilleusement marcher dans une ville, que vous l’ayez visitée ou non, « Madrid » de Luis Carandell, un Catalan né à Barcelone en 1929 mais qui selon ses propres mots renaquit à Madrid en 1947. Luis Carandell propose cette subtile définition de la tertulia (un mot si spécifiquement espagnol qu’il est préférable de ne pas le traduire) : « Cuando un grupo de personas se reúne para hacer algo concreto, el resultado puede ser un partido político, un negocio o una asociación de carácter deportivo o recreativo. Cuando se juntan para no hacer absolument nada, eso es una tertulia. No persigue otro fin que el de cultivar el puro placer de la conversación ». Inutile de traduire ! Et vive la tertulia !
 Gran Vía, Madrid.
Gran Vía, Madrid.
Une très belle remarque de José Ortega y Gasset dans « España invertebrada » (je propose la traduction suivante) : « Des races se sont caractérisées par une abondance quasi-monstrueuse de personnalités exemplaires derrière lesquelles il n’y avait qu’une masse limitée et rebelle. Ce fut le cas de la Grèce et c’est ce qui explique son instabilité historique. Il arriva un moment où la nation hellénique était comme une industrie qui ne faisait plus qu’élaborer des modèles au lieu de se limiter à fixer des standards, à partir desquels fabriquer une abondante marchandise humaine (y fabricar conforme a ellos abundante mercancía humana). Géniale par sa culture, la Grèce fut inconsistante en tant que corps social et État. »
Et je résume ce qui suit sans me livrer à une traduction systématique. Je précise que ces passages figurent au début de « La ausencia de los ‟mejores” », sixième chapitre de la deuxième partie de « España invertebrada » qui porte le titre de ce chapitre. Je rappelle que ces pages ont été rédigées dans les années 1920 : La Russie et l’Espagne offrent le cas inverse de la Grèce. Ces deux pays situés aux opposés de l’Europe manquent d’individus remarquables. La nation russe présente un corps énorme doté d’une tête minuscule (una enorme masa popular sobre la cual tiembla una cabeza minúscula). D’où l’aspect protoplasmique, amorphe et résolument primitif qu’offre la vie russe. Dans le cas de l’Espagne, José Ortega y Gasset note que tout s’y est fait par le peuple (pueblo) et non par des personnalités autonomes capables d’adopter des attitudes fortement individualisées et en toute conscience, un phénomène rare, très rare dans ce pays. Il note par ailleurs que l’art espagnol est magnifique dans ses manifestations populaires — anonymes —, chant, danse, céramique (plus généralement les arts populaires) mais plutôt pauvre dans ses formes érudites et personnelles (personnalisées). Entre l’individu génial et la masse, il n’y a pas d’intermédiaire. L’individu d’exception reste isolé, ses travaux sans effet sur le niveau général. A l’Espagne, José Ortega y Gasset oppose l’histoire de la France et celle de l’Angleterre au cours desquelles les personnalités ont pullulé. En comparant ces histoires « saltará a la vista el carácter anónimo de nuestro pasado contrastando con la fértil pululación de personalidades sobre el escenario de aquellas naciones ». L’histoire de la France et celle de l’Angleterre ont été essentiellement faites par des minorités (on n’ose dire des élites), tandis que l’Espagne s’est faite avec le peuple, directement « o por medio de su condensación virtual en el Poder público, político o eclesiástico ». Et José Ortega y Gasset fait remarquer très justement que lorsqu’on visite une vieille ville d’Espagne, on reste frappé par la magnificence des édifices religieux et publics tandis que les créations individuelles y sont fort rares. L’architecture civile privée est modeste voire pauvre, y compris les « palais » au fronton desquels gesticulent des blasons. Cette remarque m’a d’autant plus frappé que je me la suis très souvent faite au cours de mes voyages en Espagne. Et ce qu’il ajoute n’est pas moins pertinent : « Si se quitan a Toledo, a la imperial Toledo, el Alcázar y la Catedral, queda una míseria aldea » (Si on enlève à Tolède, à la Tolède impériale, l’Alcazar et la Cathédrale, il ne reste qu’une misérable bourgade). Il faut relire et relire José Ortega y Gasset à l’heure où l’inculture générale (volontiers véhiculée par les mass media) favorise la perte de conscience des spécificités, autant de richesses. Opposer José Ortega y Gasset l’Européen à l’Europe des abrutis, à l’Europe abrutie.
 Cuesta de Moyano (calle de Claudio de Moyano), Madrid, una caseta.
Cuesta de Moyano (calle de Claudio de Moyano), Madrid, una caseta.
Parmi les magnifiques titres que propose la littérature classique espagnole, « Voz de la letra » d’Alonso Zamora Vicente, publié dans la Colección Austral (Espasa-Calpe, S.A.), des livres à la maquette sévère et au catalogue d’une immense richesse — et il l’était avant même la mort de Franco. Je pars à leur recherche chaque fois que je passe par la Cuesta de Moyano (calle de Claudio de Moyano), à Madrid, cette rue qui mène au Parque del Retiro, bordée sur l’un de ses côtés par le Palacio de Fomento (aujourd’hui siège du Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) qui me fait immanquablement penser à Franz Kafka — je l’imagine travaillant dans l’un des bureaux de cette immense et étrange construction de la fin du XIXe siècle. Dans le livre d’Alonso Zamora Vicente, un article intitulé « Tirso de Molina, escritor cinematográfico » où l’auteur suggère d’adapter au cinéma (a la pantalla) du XXe siècle ces scènes du XVIIe siècle peintes par Tirso de Molina, à commencer par celles (de garbo picaruelo) qui figurent dans « Don Gil de las calzas verdes » et « No hay peor sordo… ». Alonso Zamora Vicente termine son article sur ces mots : « De agradecer sería cualquier propósito de adaptar la escena del siglo XVII — en especial Tirso de Molina — a la pantalla del siglo XX. Quizá el resultado fuere — ojalá fuere — una más eficaz mirada hacia adentro, un esfuerzo por luchar contra la tremenda anonimia — tremenda, sí — de nuestro seriado vivir de hoy. »
Feuilleté un livre lu il a une dizaine d’années, à Cordoue : « Los españoles en la historia » (1947) de Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), un livre captivant au sens le plus strict du mot. Aujourd’hui encore, et malgré la mondialisation (mot peu pertinent sous ses grands airs : le monde se mondialise depuis qu’il est monde), je prends note de la pertinence toujours vivace de nombre de ses propositions, tant dans la vie politique du pays que dans la rue, au quotidien : Espagne, individualismo, regionalismo (espíritu localista), etc. Ramón Menéndez Pidal ou la recherche historique avec pour vecteur principal la philologie. Une ivresse à chaque page, à chaque phrase ! Ramón Menéndez Pidal, une œuvre véritablement monstrueuse tant par son volume que par sa qualité.
(à suivre)
Olivier Ypsilantis