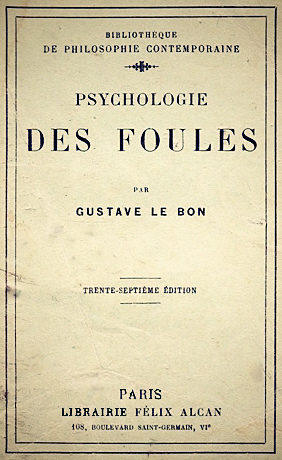« L’importance sociale d’une idée n’a d’autre mesure réelle que la puissance qu’elle exerce sur les âmes. Son degré de vérité ou d’erreur ne présente d’intérêt qu’au point de vue philosophique », Gustave Le Bon.
« Assurances contre les accidents, création de maisons ouvrières, retraites, hygiène, éducation, crédit agricole, développement de la mutualité, organisation de la prévoyance, etc., sont des preuves évidentes de la sollicitude générale. Ce n’est pas là du socialisme, c’est du devoir social, chose bien différente », Gustave Le Bon.
Gustave Le Bon (1841-1931)
Je me souviens d’avoir découvert Gustave Le Bon dans la bibliothèque d’une grand-tante par un titre qui m’intrigua : « Psychologie des foules » (publié en 1895). Je devais avoir quinze ou seize ans et il pleuvait à verse. Je me suis calé dans une méridienne (je pourrais la décrire) et j’ai commencé par ouvrir ce livre un peu au hasard, subjugué, avant d’en faire une lecture méthodique. Je me souviens de la couverture vert très pâle de ce livre, le plus connu d’un écrivain malheureusement trop oublié. L’édition que j’avais entre les mains était celle de la Librairie Félix Alcan (108, boulevard Saint-Germain, Paris, VIe arrondissement), l’édition de 1905.
Cet article m’a été en partie inspiré par la lecture de la thèse d’histoire des idées politiques de Gustave Le Bon parue en 1986, aux Presses Universitaires de France (P.U.F.) et signée Catherine Rouvier, docteur d’État en Droit public et en Sciences politiques de l’Université Paris II (Panthéon-Assas), ancienne élève de Sciences Po Paris et professeur à l’Université de Paris XI (Orsay).
Gustave Le Bon m’a d’emblée fasciné. Il a observé cette manie latine (française en particulier) de vouloir « faire le bonheur des peuples malgré eux », une dénonciation basée sur l’observation de la politique de colonisation, française plus particulièrement. Il pose la question : Comment la métropole s’y prend-elle ? Réponse : En expédiant « des légions de fonctionnaires » ; et, goguenard, il enfonce le clou : « C’est à peu près d’ailleurs notre seul article d’exportation sérieux ! »
Gustave Le Bon (un homme à lire et à relire car politically incorrect) notait il y a environ un siècle que nous, Européens, sous-estimons la puissance de la religion en Asie. Lisez bien, il écrit : « Les institutions politiques des Orientaux, qu’il s’agisse des Arabes ou des Hindous, dérivent uniquement de leurs croyances religieuses… Il n’y a pas de code civil en Orient, il n’y a que des codes religieux ; une nouveauté quelconque n’y est acceptée qu’à la condition d’être le résultat de prescriptions théologiques ». A bon entendeur, salut ! Et pour finir, une prophétie du même qui ne se voulait en rien prophète (et cette considération à plus de cent ans) : « Loin de disparaître, leur influence (des mahométans) grandit chaque jour ». Une différence, et de taille, entre Arabes et Hindous. Les Arabo-musulmans cherchent à convertir le monde entier, tandis que les Hindous restent entre eux. On naît hindou, on ne le devient pas.
L’islam et le socialisme ont des points communs, jusqu’à un certain point il est vrai… Il s’agit de deux religions de masse, de deux religions massifiantes, massificatrices.
Gustave Le Bon et le socialisme, on y vient… Mais, tout d’abord, entendons-nous. Gustave Le Bon n’est ni anti-républicain, ni anti-démocrate comme certains le laissent entendre ; il est anti-socialiste comme l’est tout homme épris de liberté. Dans l’un de ses ouvrages, « Psychologie du socialisme », moins connu que « Psychologie des foules », il décrit ainsi le socialisme et dès les premières pages : « Le pays ne serait plus qu’une sorte d’immense couvent soumis à une sévère discipline maintenue par une armée de fonctionnaires ». Un couvent ? Pour Gustave Le Bon, le socialisme est un étatisme mais aussi… une religion.
Le socialisme est bien une religion : il est beaucoup plus « une croyance à forme religieuse » qu’une doctrine. Le socialisme est venu tout naturellement prendre la place de religions anémiées. Il est « venu à l’instant précis où le pouvoir des vieilles divinités a considérablement pâli ». Mais s’il y a religion, il y a dogme. Oui, nous dit Gustave Le Bon, mais les dogmes (la doctrine) ne se structurent et ne s’imposent vraiment que lorsque la croyance (à forme religieuse) a triomphé ; et après on bidouille, en s’efforçant de « mettre d’accord les principes formulés par ses fondateurs avec les faits nouveaux qui les contredisent trop nettement », à la manière d’un théologien. Le dogme est incertain aussi longtemps qu’il n’a pas triomphé. Et on en revient à la psychologie des foules. Les foules ne s’attardent pas sur les discussions des théoriciens, les foules ne coupent pas les cheveux en quatre (l’anglais a cette belle expression : to dance on the head of a pin).
La véritable influence du socialisme et de ses dogmes se fait non par les théories (il est capable d’en pondre au moins autant qu’une poule pond des œufs), et leurs arguments économiques qui n’intéressent que quelques spécialistes, le socialisme est véritablement fort quand « il reste dans le domaine des affirmations, des rêveries et des promesses ». Ce qui était vrai il y a un siècle et plus l’est encore, même si le bavardage de la technicité s’est immiscé un peu partout. Bref, peu importe la part de vérité ou d’erreur, quand « une croyance est fixée dans les âmes, son absurdité n’apparaît plus, la raison ne l’atteint plus. »
Parmi les modifications sociales essentielles qu’entraîne la mise en œuvre du socialisme, l’emprise grandissante de l’étatisme, le socialisme reposant sur un égalitarisme qui ne peut être maintenu que par la coercition. La France s’y prête tout particulièrement, forte d’une tradition historique qui remonte bien avant la Révolution de 1789 ; et le tempérament latin (sur lequel l’auteur revient volontiers) aide aussi à la propagation du socialisme.
L’égalité, c’est le triomphe de la collectivité sur l’individu, c’est la mainmise du collectivisme sur l’individualisme, deux principes en lutte perpétuelle qui animent les sociétés humaines depuis toujours.
J’ai toujours haussé les épaules en apercevant la trilogie Liberté-Égalité-Fraternité au fronton des bâtiments officiels. Je dois porter Walden en moi. Je ne suis pas un défenseur de l’Ancien Régime ; mais le Nouveau Régime ne m’a jamais enthousiasmé. Il récupère les tares de l’Ancien ; il en corrige certes quelques-unes mais il en rajoute d’autres. Le constat est consternant : on tourne en rond ! Le plus ridicule dans cette trilogie est bien Fraternité, comme si elle se décrétait ! Et la Liberté, se décrète-t-elle ? Personne ne s’entend sur ce mot fourre-tout. C’est un véritable dialogue de sourd. L’Égalité, oui : on s’efforce de couper tout ce qui dépasse ; mais comme l’écrit Catherine Rouvier : « De cette société où ont été abolis les privilèges, les rangs et les communautés surgissent, comme de leur bois de jeunes loups affamés depuis longtemps, les ambitieux, les forts, les énergiques, les actifs de tout poil et de toute origine, bien décidés dans ce désert social à se tailler la part du lion et à restaurer à leur profit titres et privilèges ».
En citant de la sorte Catherine Rouvier, je ne cherche pas à défendre à tout prix l’Ancien Régime et à peindre un monde noir et blanc, noir pour la Révolution, blanc pour ce qui l’a précédé ; mais je refuse de basculer dans l’inverse, blanc pour la Révolution, noir pour ce qui l’a précédé. Je ne suis pas un contempteur radical de la Révolution française, en aucun cas ; je ne suis pas non plus l’une de ses groupies, en aucun cas. Trop à dire à ce sujet. Il est vrai que de nombreux contempteurs de la Révolution française me sont antipathiques ; mais étant imperméable à tout dogme (tant religieux que laïc), je n’ai aucune peine à reconnaître le bien-fondé d’un certain nombre de leurs jugements. Je préfère lire Edmund Burke que tout ce salmigondis chié par les théologiens révolutionnaires, à commencer par Saint-Just. Quant aux groupies révolutionnaires, leurs transes me répugnent et leur absence d’esprit critique me déprime lorsqu’elle ne me met pas en colère. Un mot à ce sujet : on oublie que parmi ces jeunes loups que la Révolution française fit sortir de leur bois figurent d’assez nombreux cadets de familles aristocratiques que le droit d’aînesse avait privés de moyens de subsistance, des cadets tentés par l’aventure car n’ayant rien ou presque rien à perdre. La Révolution française est aussi (et d’abord) l’histoire d’une lutte interne et complexe au sein des vieilles classes dirigeantes, de la noblesse et de ses complexités que pourrait symboliser la mort d’un roi voté par un cousin, premier prince du sang, Louis-Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, duc de Chartres puis duc d’Orléans, devenu Philippe Égalité…
Dans une société libre, l’égalité est impossible. Certes, il peut y avoir l’égalité devant la loi, ce qui n’est pas si mal, ce qui est même très bien, ce qui est essentiel ; mais cette égalité sur le papier — cette égalité codifiée — est vite contournée, et diversement, par les forts, tandis que les faibles n’ont pour toute liberté que celle de rester faibles. Car dans une société la vraie liberté est économique, matérielle, c’est ainsi ; et cette liberté engendre des inégalités qui ne peuvent être corrigées qu’autoritairement, par intervention étatique, avec redistribution. C’est alors que l’État s’impose et s’enfle. Nous avons l’État français, gorgé comme une tique. Mais, redisons-le, le volume particulier qu’a cet État n’est pas exclusivement le fait de la Révolution française qui n’a fait qu’accélérer un processus. Gustave Le Bon observe très justement que si la France est prédestinée au socialisme, c’est parce que le socialisme n’est autre chose que « l’expression ultime de l’idée monarchique dont la Révolution n’a été qu’une phase accélératrice ». Le socialisme c’est la monarchie dite « absolue » du XVIe siècle, mais en pire… Dans un cas, le bon peuple est soumis au bon vouloir du prince ; dans l’autre, il est ligoté comme Gulliver par les Lilliputiens. Et dans ce cas, il ne s’agit pas d’une métaphore du krach de 1720 mais de l’individu immobilisé dans un maillage de lois, de décrets, d’arrêtés, de circulaires, de chartes, de règlements, de codes, et j’en passe…
Certes, le socialisme est en principe soumis à l’élection ; je dis bien en principe car l’histoire a montré qu’il sait s’installer et se maintenir par la force la plus brutale. Le socialisme est donc en principe soumis à l’élection, à des mandats temporaires, mais il est tout-puissant, et sournoisement, avec cet énorme appareil administratif. En France aujourd’hui, aucun parti politique, des partis les plus à droite aux partis les plus à gauche, en passant par le centre droit, le centre gauche et le centre du centre, aucun parti politique ne lutte pour moins d’État, aucun.
Olivier Ypsilantis