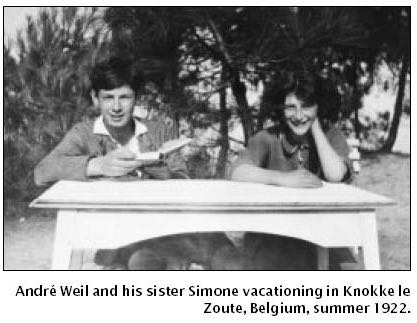Sylvie petite fille se glisse sur la pointe des pieds vers « le placard aux manuscrits » alors que ses grands-parents la croient endormie. Elle est en chemise de nuit. Elle tombe sur des considérations écrites par sa tante qui mettent le trouble sur une sexualité naissante. Simone écrit : « Le Christ lui-même est descendu et m’a prise ». Sylvie ajoute (et, une fois encore, je pense qu’elle s’est beaucoup amusée en rédigeant ces pages de souvenirs) que, pour sa part, elle pensait alors à Gérard Philippe.
Et, toujours le sourire aux lèvres, je suppose, Sylvie écrit qu’elle n’est pas même une vraie relique (souvenons-nous du « tibia de la sainte ») mais une fausse relique car : « J’ai voulu exister par moi-même ». On s’extasie sur la ressemblance entre la tante et la nièce, on va jusqu’à lui demander l’autorisation de lui toucher les cheveux tant ils ressemblent à ceux de sa tante. Mais les fans ne tardent pas à être désillusionnés : « Je ne connais même pas l’œuvre de ma tante par cœur. Je ne peux donc pas terminer les citations que l’on me tend… » Sylvie n’est donc pas une vraie relique. La vraie relique est tout de même une présence pour les fidèles, tandis que la fausse relique n’est qu’absence : « Je suis une absence. Mon propre est de ne pas être. De ne pas être Simone ». Aucun pathétisme, aucune animosité, rien qu’un constat plutôt amusé.
Sylvie hésite à accompagner son père qui l’invite à une promenade. Elle craint qu’il ne s’ennuie avec elle. L’accompagner lui semble être un programme intellectuel au-dessus de ses forces. Elle finit par décliner l’invitation, car comment être à la hauteur de ce père si exigeant ? Le faire rire serait peut-être la solution. Et pourquoi ne pas évoquer des souvenirs, certains cocasses ? Des souvenirs de promenades à Chicago ou São Paulo, par exemple.
André et Simone se ressemblaient comme des jumeaux. Sylvie ressemble beaucoup à sa tante, à son père donc. André aimait citer sa sœur mais il ne parlait jamais d’elle comme on parle d’une femme. Il disait « ma sœur » comme il aurait dit « mon frère ». Sur des lettres à sa mère, Simone avait signé ton fils Simon, « Simon, ce jumeau de mon père ». André admirait Simone. Il avait confié à un ami qu’il jugeait que sa sœur lui était bien supérieure. Simone admirait son frère et s’efforçait vers des connaissances mathématiques (voir ses cahiers couverts d’opérations et de figures) mais elle prenait de la hauteur lorsqu’elle écrivait par exemple : « Le mathématicien vit dans un univers à part dont les objets sont des signes (…) Le jeu des échanges entre signes se développe par lui-même et pour lui-même ».
Un épisode a beaucoup intéressé Sylvie (et il m’intéresse tout autant dans la mesure où il confirme des impressions que je n’osais vraiment m’avouer tant je restais impressionné par la stature de Simone), un épisode que lui a rapporté sa mère, Eveline, une femme élégante et sensuelle, le contraire de sa belle-sœur, Simone. (Aparté biographique : Eveline de Possel (née Gillet) divorça de René de Possel, l’un des membres fondateurs de « Nicolas Bourbaki », et épousa André Weil. Le couple eut deux filles : Sylvie, née en 1942, épouse Weitzner, et Nicolette, née en 1946, épouse Schwartzman). L’épisode donc. Les deux femmes, les deux belles-sœurs, sont dans le petit appartement d’André, au rez-de-chaussée du 3 rue Auguste Comte, la rue AC comme on disait chez les Weil. André est détenu à la prison militaire de Rouen pour insoumission. Rappelons que c’est là qu’il élabora l’un de ses meilleurs travaux mathématiques. Eveline considère que Simone est légèrement timbrée et Simone a peu d’estime pour l’intelligence de celle qu’a ramenée son frère, mais les deux femmes s’entendent plutôt bien. Un soir donc, elles se sont assises à même le sol, devant un bocal de cerises à l’eau-de-vie, et elles parlent de je ne sais quoi, de je ne sais qui, probablement du mari, du frère, André. A un moment, Eveline se laisse aller à passer les doigts dans la chevelure de Simone, une chevelure « qui devait lui rappeler celle d’André, qu’elle n’avait plus touchée depuis plusieurs mois ! » Mais Simone s’écarte d’un mouvement brusque en criant : « Ne me touchez pas ! ». Sylvie s’interroge : sa tante était-elle terrifiée par toute caresse parce qu’elle mourait d’envie d’en recevoir ? « S’est-elle sentie souillée par ce contact, par cette caresse venant justement de la jolie femme qui couchait avec son frère ? »
Le chapitre intitulé « Famille décollée » est lui aussi particulièrement intéressant. On y apprend que la mort de Simone détraqua progressivement les relations entre les quatre membres de la famille Weil, soit : les parents de Simone et André, Bernard (Biri) et Selma (Mime), et le couple André et Eveline. En 1952, les relations s’enveniment. Elles vont assombrir l’enfance et la jeunesse de Sylvie, et jusqu’à la mort de Selma, en 1965, Selma dont le mari était décédé en 1955. André commence par ôter sa fille à ses grands-parents, estimant « que sa mère avait créé en Simone un besoin d’elle et que Simone en était morte ». La querelle s’entendra aux manuscrits de Simone avec allers et retours entre la Bibliothèque nationale et la rue Auguste Comte. Ce fut « un divorce à quatre », à l’ombre de Simone dont la présence emplissait l’appartement du 6ème étage de la rue AC.
Bernard et Selma en vinrent à déclarer indésirables André et sa famille (soit sa femme et leurs deux filles), indignes d’occuper les lieux où Simone avait vécu, Simone la sainte, Selma mère de la sainte, et André au caractère peu conciliant dans le rôle du diable. Sylvie Weil écrit : « Je ne peux donner ni tort ni raison aux uns et aux autres. Je peux seulement dire qu’au nom de Simone ils ont réussi à donner à mes années d’enfance un goût souvent amer ».
Dans le chapitre suivant, « La métamorphose de Kuckucksei », Sylvie trace un étonnant portrait de sa grand-mère, ou plutôt une suite de portraits de cette grand-mère, car il semble qu’il y ait eu plusieurs Selma. Les deux derniers portraits : la grand-mère toute dévouée à sa petite-fille, Sylvie ; puis, dernier portrait : « la maman de Simone ». En fin de chapitre le ton s’adoucit, il finit même sur un sourire, amer certes. Ce chapitre, elle l’a commencé les mâchoires serrées, avec une rage à peine contenue face à cette grand-mère qui a fait de l’appartement une sorte de temple à la mémoire de sa fille avec, au fond du couloir, la chambre de « Simonette », le saint des saints. « Elle qui, jadis, détestait les calotins, entretenait des correspondances mystico-sentimentales avec un petit cercle d’ecclésiastiques », avec des dévots en contact avec sa présence. Bref, ces calotins (qu’elle désigne aussi du nom de cafards) ne cessent de flatter « la maman de la sainte », Mime, qui, assurent-ils, est immortalisée par Simone et en Simone. Cette grand-mère et ses « petits flirts ecclésiastiques, tellement agréables et flatteurs, avec leur cortège de tendres et respectueux baisers, et tous ces je suis avec vous, vous êtes avec moi, Simone est en nous, et nous sommes ensemble en Simone ».
Simone ! Il y a des jours (beaucoup de jours) où Sylvie n’aime pas, mais vraiment pas la sainte tante, la géniale tante. Ras-le-bol, surtout après cette conférence sur cette tante prononcée à New York, conférence qui se termine sur une déclaration d’amour amenée par une pénible (et sanglante) description de la Vierge accouchant de Jésus. Sylvie est éreintée par ce double que lui assènent les larmes aux yeux ses grands-parents qui l’élèvent. Sylvie qui a le sens de la mesure, et qui est toujours prête à sourire et à rire, enrage (rétrospectivement) quand elle pense à ces grands-parents qui souriaient peu (ou d’un sourire triste) et qui riaient encore moins. Elle détaille des photographies de ces visages « de vieux désemparés et vides » avant de tourner un visage rouge de colère vers sainte Simonette, « Simonette » comme l’appelaient Mime et Biri. Elle lui reproche ses lettres enjouées (dans la mesure où Simone pouvait l’être) dans lesquelles elle dissimule la mort qui approche, une mort qu’elle a en partie organisée. Et lisez ce reproche atroce et justifié, d’un certain point de vue : « Ce n’est pas comme si tu les avais quittés malgré toi. Comme si tu avais été déportée, fusillée. Ce n’est pas un deuil ordinaire que celui d’une fille qui tenait absolument à se détruire et qui y a réussi ! » Et ce n’est pas fini : « La guerre, la fuite, l’exil, l’extermination de six millions des leurs, dont un certain nombre de très proches parents partis de Drancy pour Auschwitz par le convoi 67, le 3 février 1944, ils en parlaient à peine, c’était comme si le deuil de tout un peuple disparu s’était entièrement concentré, ramassé, dans un deuil unique, le deuil de toi ». Je devrais m’arrêter et vous laisser lire ce livre. Mais je continue. Une force m’entraîne.
Il y a donc cette rage face à la sainte qui trône au plus haut des cieux. Pourtant, un jour « où je te détestais, j’ai rencontré un homme qui t’avait connue à Londres pendant la guerre ». Il faut lire le chapitre intitulé « Indestructible ? » Cet homme fit donc un portrait très précis de Simone, un portrait de la fin 1942. Elle n’était pas sur un piédestal, elle ne flottait pas dans l’azur de la sainteté. « Donc, un jour que je te détestais, j’ai rencontré un homme qui t’avait connue à Londres pendant la guerre. Et les mots que cet homme a employés pour te décrire m’ont bouleversée ». Il évoqua Simone avec une précision cinématographique, loin des grands mots et des images pieuses. A Londres Simone se morfondait car on refusait de la parachuter en France, probablement parce qu’elle était vraiment trop maladroite ! Ne s’était-elle pas ébouillantée au cours de la Guerre d’Espagne, lorsque, milicienne à la CNT, elle avait mis le pied dans une marmite d’huile bouillante, une maladresse qu’accentuait sa très forte myopie ? Le Général de Gaulle l’avait traitée de folle lorsque qu’après avoir rallié Londres à l’automne 1942 elle avait demandé à être infirmière de première ligne. Il l’avait encore traitée de folle lorsqu’elle avait demandé à être parachutée en France. Le général lui interdira de quitter l’Angleterre et la nommera responsable du Bureau des Affaires Intérieures afin qu’elle réfléchisse à l’orientation à donner à la France après sa libération. Dans un bureau proche, René Cassin travaillait sur ce qui deviendra la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et qui sera adoptée par l’ONU après la guerre.
Certes, on admirait sa détermination et son courage, mais sa maladresse avait compliqué et compliquerait les missions de ses camarades de combat. On se disait qu’à l’atterrissage elle risquait de se casser une cheville voire les deux jambes. Bref, ses projets guerriers faisaient tout au plus sourire ; et Sylvie Weil a cette remarque qui mérite que l’on si arrête: « C’est peut-être ce qui l’a brisée, bien plus que la tuberculose. »
 Marseille, printemps 1941. Simone Weil et son béret basque, un couvre-chef qu’affectionnait la famille Weil. Sylvie Weil : « Le béret de mon père est exactement pareil à ceux que portaient son père, sa mère, sa sœur. Posé de la même façon. »
Marseille, printemps 1941. Simone Weil et son béret basque, un couvre-chef qu’affectionnait la famille Weil. Sylvie Weil : « Le béret de mon père est exactement pareil à ceux que portaient son père, sa mère, sa sœur. Posé de la même façon. »
Simone indestructible. C’est l’image qu’en avait son frère, André. Aussi les souvenirs londoniens de cet homme ne pouvaient que bouleverser Sylvie qui écrit : « Cette trollesse abandonnée m’a émue, cette trollesse qui, après tout, fait partie des miens ». Trollesse, l’un des noms par lequel Sylvie désigne sa tante et qui revient assez souvent sous sa plume. Tout est bien qui finit bien, se dira-t-on. Mais le chapitre « Indestructible ? » a un post-scriptum : « Vois-tu, il m’a aussi affirmé, cet homme qui t’a rencontrée à Londres fin 1942, que vous saviez les rafles, les déportations, les enfants, les bébés juifs arrachés à leurs mères (…) Alors, si vous étiez au courant, pourquoi, pourquoi du fond de ton propre désespoir dont seuls tes parents auraient pu te tirer, c’est toi-même qui l’écris, pourquoi n’as-tu pas eu une pensée, en tout cas pas un mot pour tous ces bébés juifs fous de terreur, si cruellement séparés de leurs mères ? » Cette question me replonge dans mon grand malaise (entre rage et dégoût) face à ses rapports au judaïsme, au peuple juif, face à un rapport au Christ qui confine à l’hystérie.
Si j’admire cette femme, malgré tout, ce n’est pas pour les raisons sur lesquelles caracolent les Chrétiens, catholiques plus particulièrement. Cette volonté de se détruire (pour s’atteindre ?) m’énerve. Sylvie écrit : « Le vrai projet de Simone, c’est d’éprouver la peine des pauvres, non de leur fournir du pain et des vêtements. Sa forme de charité, à elle, c’est de devenir le mendiant et de refuser qu’on la soulage ». C’est précisément le constat que je m’étais fait en lisant cette femme aussi admirable qu’exaspérante. Son intelligence est hautement stimulante mais ses transes (surtout devant le Christ) me tapent sur les nerfs. Quant à ses propos sur le judaïsme et le peuple juif, ils sont tout bonnement atroces, parce que profondément injustes. Son désir de martyre (je n’ose évoquer des tendances sadomasochistes) l’entraîne dans des dénonciations insensées, délirantes. A ce niveau, ce n’est plus le raisonnement qui peut quelque chose mais l’exorciste ou un puissant anxiolytique… On n’en finit pas avec Simone Weil.
Ci-joint, un très riche lien biographique (en anglais), avec nombreuses entrées, concernant André Weil :
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Weil.html
Et lisez cette étrange lettre de Simone Weil à Xavier Vallat, alors Commissaire général aux questions juives :
Olivier Ypsilantis