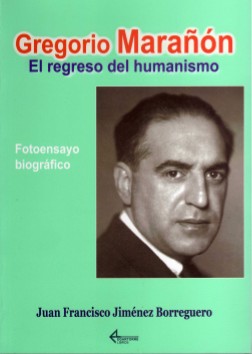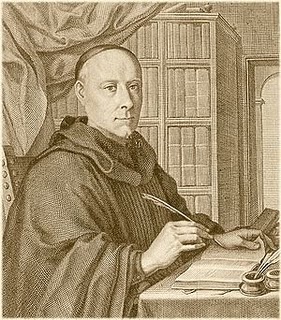En souvenir de René Lévy, ce grand disciple d’Oshawa qui enseignait le mieux-vivre en sa fondation « Cuisine et Santé » de Saint-Gaudens. Il fut à sa manière un digne compagnon de Maïmonide, d’Erasme et de Vives.
Juan Luis Vives, ce chrétien descendant de conversos, est né l’année de l’expulsion des Juifs d’Espagne. Il fut un grand Européen comme le fut celui que j’ai choisi pour m’aider à vous évoquer cet humaniste, ami d’Erasme. Celui que j’ai choisi comme guide n’est autre que Gregorio Marañón (1887-1960), un homme du XXème siècle dont la stature est comparable à celle des grands de la Renaissance, parmi lesquels Juan Luis Vives. L’œuvre de Gregorio Marañón est si vaste et d’une telle qualité qu’on se demande comment un seul homme a pu mener à bien une telle œuvre. Car, outre sa production littéraire, qui le place au premier rang des lettres espagnoles, il fut professeur de médecine et l’un des meilleurs endocrinologistes de son temps, un géant donc, un homme digne de la Renaissance… et en plein XXème siècle. Ses contributions à l’endocrinologie (cette branche de la médecine subtile entre toutes) ont été pionnières. Ainsi a-t-il notamment montré les liens si tenus et si nombreux qui unissent psychologie et endocrinologie. Il a par exemple appliqué une certaine méthode d’analyse au donjuanisme (“Don Juan y el donjuanismo”), à la personnalité d’Enrique IV de Castilla (“Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo”), à Amiel (“Amiel, un estudio sobre la timidez”) et j’en passe. Bref, par sa stature et ses préoccupations Gregorio Marañón fut l’égal de Juan Luis Vives qu’il admirait et qu’admirait l’un de ses maîtres, Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de médecine 1906.
Les pages que Gregorio Marañón dédie à Vives constituent l’une des parties de “Españoles fuera de España”, un livre ainsi articulé : “Influencia de Francia en la política española a través de los emigrados”, “El destierro de Garcilaso de la Vega”, “Luis Vives. Su patria y su universo” enfin. Le plaisir que j’ai à mêler deux de mes plus profondes sympathies espagnoles ‒ Juan Luis Vives / Gregorio Marañón ‒ est grand.
Il arrive que je me plaigne de la méconnaissance qu’ont les Français d’un homme tel que Juan Luis Vives, un homme dont beaucoup ignorent jusqu’au nom. Gregorio Marañón se plaignait pareillement de ses compatriotes, de “la distracción de los españoles ante la obra del filósofo y precursor valenciano”. Ignacio de Luzán (1702-1754), quant à lui, déplore (dans “Memorias literarias de París”) que “Institución de la mujer cristiana” de Juan Luis Vives ne soit pas entre les mains de tous les Espagnols.
Vives mourut à l’âge de quarante-huit ans, suite à des maux chroniques : goutte (gota) et calculs urinaires (mal de piedra). Le docteur Marañón pose son diagnostic : on n’est pas goutteux par hasard, comme on peut être tuberculeux ou cardiaque. La goutte est un indice, poursuit-il, qui nous parle de traits particuliers d’un caractère, d’une pensée. Le goutteux est un amoureux de la vie, il dévore la vie ; mais il se voit limité dans sa jouissance même, dans son appétit de vivre, pris qu’il est dans les entraves élaborées par sa propre exubérance vitale, une exubérance qui en s’autolimitant suscite un balancement fécond entre le vouloir (querer) et l’impuissance à le satisfaire (no poder), une tension qui s’apaise volontiers en humour. “En el fondo del humorismo palpita ese anhelo de superioridad inalcanzada que elude la confesión de su fracaso con una sonrisa ; y algunas veces lo entierra en un resentimiento ennoblecido”. Pío Baroja s’est lui aussi interrogé sur la relation entre la goutte (goto ou artritismo) et la propension à l’humour (humorismo), entre humour (humor) et humeur (humor). Vives, homme de la Renaissance et filósofo gotoso, est empreint d’indulgence et de sérénité sous laquelle court une inquiétude pérenne qui se fait volontiers humour. Notons qu’une telle attitude ne se rencontre guère chez l’Espagnol de Castille mais plus volontiers chez l’Espagnol de la périphérie, du Levant notamment, de la façade méditerranéenne du pays, dont est originaire ce valenciano.
Le docteur Marañón nous rappelle qu’au cours de la Renaissance tous les grands (rois, papes, grands artistes et grands soldats) souffraient de la goutte des membres supérieurs (chiragra) ou inférieurs (podagra). Erasme, avec lequel Vives voyagea en Europe, souffrait lui aussi de la goutte et de calculs urinaires.
Vives évoque sa maladie dans “Diálogos” où il invite à la frugalité, fort de son expérience, de sa douloureuse expérience. Et je pourrais évoquer Maïmonide qui “fit des miracles” simplement parce qu’il avait compris que bien des problèmes de santé peuvent être atténués, voire éliminés, par une alimentation saine et en quantité raisonnable ‒ une certaine frugalité est de rigueur. “On creuse sa tombe avec ses dents” avait coutume de dire ma grand-mère. Et je pourrais évoquer la grande figure de René Lévy auquel ces pages sont dédiées. Dans “Diálogos” passe la nostalgie du paradis perdu, du manger sans frein. Dans ce paradis, la viande de porc. Crito, l’un des protagonistes, pleure le sort des Juifs, interdits de porc.
Dans “Diálogos”, Vives laisse transparaître sa très profonde connaissance de la diététique, une science encore inexistante, une simple somme de connaissances empiriques, expérimentales. Une fois encore, je pense à Maïmonide qui sut soigner tant de maux par le manger raisonnable.
__________
Vives représente en Espagne la première expérience intellectuelle qui sut accueillir avec un tel bonheur une telle charge expérimentale. Son influence s’est fait sentir principalement au XVIIIème siècle, après une période de relatif oubli. Vives peut être envisagé comme l’une de ces “semillas experimentalistas” qui fleurirent au siècle des Lumières. El Padre Feijóo (1676-1764) est l’auteur d’une œuvre essentielle pour capter l’esprit de ce siècle, une œuvre qui doit beaucoup à Vives, cet homme du XVIème siècle. Lire à ce propos : “Las ideas biológicas del padre Feijóo” de Gregorio Marañón qui remarque que le mouvement intellectuel qui marqua le XVIIIème siècle n’est pas le fait d’un obscur complot, ainsi que le proclama avec entêtement une certaine Espagne ‒ anti-libérale. Le XVIIIème siècle, nous rappelle Gregorio Marañón, a aussi des sources espagnoles ; et Vives fut l’une d’elles, et non des moindres. Le cours de cette source est théologique (voir el Padre Feijóo), et aucunement hétérodoxe.
Certains aspects de l’œuvre de Vives ont été peu traités par ses commentateurs, en particulier ses considérations à caractère hygiéniste qui émaillent son œuvre, considérations particulièrement appuyées dans “Diálogos”. Lorsqu’il écrivit ce livre, Vives était proche de la mort. Ses conseils s’appuyaient sur une connaissance des plus profondes, basée sur une expérience qu’il traduisit en “preocupación experimentalista”. Azorín a souligné dans l’une de ses admirables “Lecturas españolas” le poids de la charge autobiographique de “Diálogos”, particulièrement lorsqu’il est question de santé. Fort de son expérience ‒ de ses souffrances ‒ Vives prodigue donc ses conseils. Ses conseils ? Commencer par se lever tôt, ce à quoi invitera Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de médecine 1906, autre admirateur de Vives. Se lever tôt car le monde n’est jamais plus kóσμος qu’à l’aube, “al claror virginal de la madrugada”. Suivent des conseils relatifs à la toilette et à la manière de se peigner : avec un peigne dur en passant sur le cuir chevelu au moins quarante fois ; rien de tel pour limiter les effets de la calvitie. Autre conseil : restreindre les quantités de nourriture et incliner vers un régime végétarien, non pas fanatiquement ‒ Vives est tout le contraire d’un fanatique ‒, en limitant autant que possible la consommation de viande, en préférant les figues fraîches, le fideo, le riz, les lentilles, les amandes et les noisettes ; bref, préférer une nourriture simple, peu élaborée ‒ comme l’est toute nourriture saine. Et consommer en quantité raisonnable, car “cuanto basta, no para hartar, sino para alimentar”.
En lisant les conseils de Vives sur la manière de se tenir à table, on ne peut que penser à ceux prodigués par son ami Erasme dans “De civilitate morum puerilium”. Vives invite par exemple à ne pas se récurer les dents à table avec son couteau. Il conseille à cet effet une plume ou un petit morceau de bois effilé. A ce propos, un souvenir me revient. On rapporte que le cardinal de Richelieu, las de voir le chancelier Séguier se curer les dents avec son couteau, ordonna à son maître d’hôtel de faire arrondir tous les couteaux afin d’empêcher son hôte de se livrer à son récurage. C’est Antonio Pérez, secrétaire de Felipe II (dont il est question dans “Españoles fuera de España” et auquel Gregorio Marañón a par ailleurs consacré de nombreuses pages), qui a rendu populaire le cure-dents en France. Et Gregorio Marañón conclut : “Pero consignemos con satisfacción que la trascendental higiene de la boca preocupó a dos compatriotas nuestros cuando, en Europa, apenas preocupaba a nadie”. Ses deux compatriotes : Juan Luis Vives et Antonio Pérez.
Les mises en garde de Vives se succèdent. Il recommande la sobriété quant à la nourriture et la boisson. Il prodigue ses conseils sur le mélange eau/vin et fait cette remarque, à savoir que l’eau destinée à ce mélange ne doit être ni de citerne ni de fontaine ni de pluie mais de rivière, à la condition que “los ríos pasan por minerales de oro, como comúnmente en España”. Gregorio Marañón croit lire dans ce conseil comme une nostalgie de la lointaine patrie, l’Espagne. Certaines préoccupations du Padre Feijóo, disciple de Vives, eurent elles aussi trait à l’eau. Ce sont des conseils amicaux, basés sur l’expérience ‒ la souffrance.
Les conseils de Vives me ramènent à ceux de René Lévy, de Saint-Gaudens. Il me reprenait avec gentillesse et fermeté lorsque je mangeais à sa table : “Olivier, vous mangez trop vite ! Il faut que vous appreniez à boire ce que vous mangez et à manger ce que vous buvez ; autrement dit : mâchez, mâchez et mâchez encore ! Votre estomac doit travailler le moins possible ! Et évitez de boire pendant les repas !”
Je vous ai rendu brièvement compte des deux premières parties de “Espanoles fuera de España” qui en compte cinq. J’espère vous avoir donné l’envie de poursuivre et de découvrir l’œuvre de cet humaniste et de ce grand Espagnol que fut Gregorio Marañón sur lequel je me suis appuyé pour évoquer cet autre humaniste et grand Espagnol, Juan Luis Vives. Gregorio Marañón dit de Vives qu’il fut “una de las cabezas más liberales y nobles que dio a la Humanidad España”. Je reprends cette appréciation de l’auteur de “Espanoles fuera de España” pour l’appliquer à son auteur en personne.
__________
Il existe de nombreuses études consacrées à Juan Luis Vives. Je conseille tout particulièrement celle de Carlos G. Noreña, “Juan Luis Vives”, Ediciones Paulinas – 1978 – Colección Filosofía. Ce livre d’un Espagnol expatrié aux États-Unis a été écrit en anglais et traduit à l’espagnol par Antonio Pintor-Ramos. Il existe d’autres études de Carlos G. Noreña sur le même sujet, tous de la plus haute qualité. J’en conseille également la lecture car l’érudition y est pétrie de sympathie, et c’est bien ce que nous recherchons. Le “Juan Luis Vives” ci-dessus mentionné est partiellement consultable en ligne et dans l’original, en anglais donc, aux éditions Martinus Nijhoff (Den Haag).
Qui était Juan Luis Vives ? Cet homme fut la “coqueluche” du pape Adriano VI, des têtes couronnées (parmi lesquelles Carlos V), des meilleures universités et des plus grands penseurs d’alors dont Erasme, Thomas More et Guillaume Budé. Il fut imprimé dans toute l’Europe et traduit dans les principales langues européennes. Il fut un guide. Et lorsque j’en viens à douter de l’Europe, des valeurs particulières qu’elle représente, je pense à lui, à ce chrétien d’origine juive, né dans ce Levant espagnol qui fut l’un des lieux bénis de notre monde, lieu dont j’ai goûté la beauté malgré les blessures du bétonnage côtier, de l’extension des faubourgs et de la ramification des rocades qui ont écrasé et sectionné la huerta valenciana, la plus belle d’Espagne.
Juan Luis Vives est né à Valencia en 1492 ‒ peut-être en 1493. L’année 1492 vit en Espagne : la chute de la dernière enclave musulmane (le royaume de Granada), l’expulsion des Juifs de Castilla et Aragón, la découverte de l’Amérique par Cristóbal Colón et la publication par Antonio de Nebrija (autre chrétien d’ascendance juive) de la première grammaire européenne en langue vernaculaire : “Arte de la lengua castellana”. A ce propos, je conseille l’étude de Bernard Vincent : “1492, l’année admirable”, une étude panoramique qui met l’eau à la bouche et invite en savoir plus, toujours plus.
Juan Luis Vives passa à Valencia les dix-sept premières années de sa vie. Valencia, une ville et une région où Juifs et Musulmans se sentaient si bien que nombreux furent ceux qui se convertirent pour ne pas avoir à s’exiler. Les origines juives de Vives intriguèrent, comme intriguèrent celles de santa Teresa de Ávila. On les supposait, inquiet, sans vraiment les avoir étudiées. Un exemple significatif : en 1947, Lorenzo Riber, membre de la Real Academia Española de la Lengua, déclarait : “Nos duele enormemente ver mancillado con esa tacha ancestral al más cristiano de los epígonos del Renacimiento”. Une souillure ancestrale sur la plus chrétienne des grandes figures de la Renaissance ! En 1964, des documents irréfutables furent publiés par Miguel de la Pinta y Llorente, spécialiste de l’histoire de l’Inquisition, et José María Palacio y Palacio, archiviste valencien, sous le titre “Procesos inquisitoriales contre la familia judía de Luis Vives”. Ils montraient que Juan Luis Vives était d’origine juive tant par son père, Luis Vives Valeriola, que par sa mère, Blanquina March y Almenara.
Vives eut un frère, Jaime, et trois sœurs : Beatriz, qui le rejoignit à Bruges en 1531 ; Leonor et Ana, dont le mari eut affaire à l’Inquisition. La mère se convertit au christianisme en 1491, soit un an avant le décret d’expulsion. Elle mourut de la peste en 1509. Alors qu’il n’avait que dix-sept ans, le père eut lui aussi affaire à l’Inquisition. Et à l’issu d’un procès (qui se déroula entre 1522 et 1524) il fut “entregado al brazo secular”, autrement dit : condamné au bûcher. En 1525, les sœurs finirent par récupérer, au cours d’un autre procès, l’héritage de leurs parents, héritage qui leur avait été confisqué par l’Inquisition. En 1528, soit près de vingt ans après la mort de la mère, Blanquina, autre procès au cours duquel il fut établi que cette dernière s’était rendue à la synagogue après sa conversion. En conséquence : ses restes furent exhumés du cimetière chrétien où ils reposaient et brûlés publiquement ; et ses filles furent privées de leur droit à l’héritage.
Mais j’y pense, plutôt que de vous communiquer un compte-rendu, nécessairement plus pauvre que l’original, je vous invite à lire l’intégralité de “Juan Luis Vives” de Carlos G. Noreña, ainsi que l’ensemble des travaux que ce chercheur consacre à cet humaniste. Je vous invite également à consulter l’étude de Luis E. Rodríguez – San Pedro Bezares et José Luis Sánchez Lora intitulée “Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida quotidiana” (Editorial Síntesis, S.A.), une étude qui propose une vision aussi précise que panoramique et qui peut être envisagée comme un beau complément tant à “Juan Luis Vives” de Carlos G. Noreña qu’à cet exercice de sympathie auquel nous convie Gregorio Marañón.
Olivier Ypsilantis